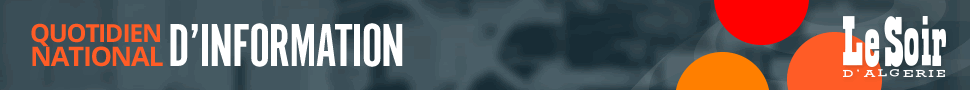«L'Histoire est un mensonge que personne ne conteste… la vérité historique est souvent une fable convenue… la vérité de l'Histoire ne sera probablement pas ce qui a eu lieu, mais seulement ce qui sera raconté…Vous devez tout voir, tout entendre et tout oublier. »
(Napoléon Ier)
Par Dr Mourad Betrouni
 J’avoue mon incompétence dans la lecture des messages politiques, qui puisent dans une grammaire et une sémantique dont seuls les concernés ont les clés du déchiffrement, ce qui me commande, par honnêteté et surtout par prudence, de ne pas me hasarder dans des analyses, surtout devant l’absence d’un recul suffisant, qui risquent d’être inopportunes. Ceci en avant-propos à ma réaction sur un sujet brûlant, un «pavé dans la mare », comme dirait l’autre, jeté par le président de la République française, qui a mis en doute l’existence même de la Nation algérienne.
J’avoue mon incompétence dans la lecture des messages politiques, qui puisent dans une grammaire et une sémantique dont seuls les concernés ont les clés du déchiffrement, ce qui me commande, par honnêteté et surtout par prudence, de ne pas me hasarder dans des analyses, surtout devant l’absence d’un recul suffisant, qui risquent d’être inopportunes. Ceci en avant-propos à ma réaction sur un sujet brûlant, un «pavé dans la mare », comme dirait l’autre, jeté par le président de la République française, qui a mis en doute l’existence même de la Nation algérienne.
Je suis préhistorien et mon métier consiste à remuer les sédiments pour voir ce qui est enfoui et ce qui est caché au regard, pour le mettre en affleurement et le faire découvrir au monde. Et comme je suis un enfant de l’indépendance – né dans une famille de martyrs – j’ai toujours été troublé face à un sentiment de doute, vécu par certains de nos aînés, quant à la question de la Nation algérienne, ce pain bénit pour certains politiques et affiliés, pour qui l’Algérie est une création ex nihilo, sans profondeur historique. Or, il suffirait juste de traverser quelques hauteurs de sédiments pour s’apercevoir que l’Algérie est une épaisseur que l’on traverse et non un fil de l’histoire sur lequel on se déplace pour n’observer que les affleurements ultimes.
C’est sur le terrain du doute, justement, que le Président français s’est essayé, en osant la question, sans toutefois disposer des outils qui lui auraient permis le démontage et la déconstruction. Ce sont d’autres, tapis dans les arcanes de l’épistémè et de la méthode, qui ont le mode d’emploi. C’est à ceux-là, d’ici et de là-bas, qu’il faut répondre, pour le reste, c’est aux politiques d’apprécier.
Pour s’en tenir à l’écrit, entendons-nous, d’abord, sur le mot «Algérie», dérivé de l'arabe « Al Djezaïr ». Ce mot n’a pas été inventé par la France, comme on a tendance à le faire croire. Il a remplacé, en 1837, le libellé «possessions françaises de l’Algérie», à l'initiative du maréchal Soult. Il n’a aucune signification en soi sans l’ajout de l’adjectif «française », pour désigner explicitement «l’Algérie française», au moment même où l'Émir Abdelkader et le général Bugeaud signaient le traité de la Tafna, un certain 30 mai 1837, qui partageait le territoire en deux possessions. Les «possessions françaises» et celles de l’Émir Abdelkader, qui couvraient les deux tiers du territoire, dont les provinces d'Oran, de Koléa, de Médéa, de Tlemcen et d’Alger, en plus du territoire routier entre Alger et Constantine. Deux années après, en 1839, la France violait le traité de la Tafna, au lendemain de la prise de Constantine, en 1837. La guerre durera encore une dizaine d’années, jusqu’en 1847.
Au sujet de la notion Algérie, il est opportun de ressusciter les propos de M. Roland Cadet, négociateur des accords d’Évian, côté français, lorsqu’il s’agissait d’argumenter le « vide saharien » : « L’Algérie, au contraire, n’est ni le vide ni le désert : les auteurs arabes l’ont toujours comparée à une île, l’île de l’occident, et Djeziraïd El Maghreb, entourée de deux barrières difficiles à franchir, la Méditerranée et le désert… » Sans détour fastidieux, depuis la défaite de l’Émir Abdelkader en 1847, l’Algérie est tombée sous la domination française, jusqu’au 1er novembre 1954, date du déclenchement de la Révolution algérienne. Après 7 ans de guerre, la France coloniale est vaincue. Elle quitte l’Algérie en 1962, restituant le territoire dans ses ultimes parcelles.
Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, plutôt d’« El Djazaïr », voilà que de nouveaux démons surgissent des profondeurs d’une mémoire mal assumée, pour venir au secours d’une Nation vieillissante, en ressuscitant le sentiment nostalgique de l’Algérie française, comme procédé thérapeutique à effet placebo, agissant sur la sensibilité mémorielle d’une certaine France, convoquant souvenir impérial et œuvre de civilisation. Une entreprise qui peine à dissimuler les causes profondes du malaise français, le caractère dogmatique et figé de son modèle national, inopérant face aux nouveaux défis mondiaux, dont la révolution numérique, qui a mis à nu tous les usages, jusqu’aux identités intimes, au moyen de menus artifices technologiques, pour créer de nouvelles souverainetés.
D’un mot, la France a peu à peu perdu pied dans son ancien empire africain; l’Algérie n’en est que son souffre-douleur. C’est l’origine même de son angoisse et son désenchantement, qui explique cet affolement et cette panique, au point de ressusciter Napoléon, Colbert et Gauguin, pour réinventer le « beau », en l’opposant à son revers, la barbarie, dans son lien matriciel à l’immigration et sa menace teintée de vert. Un sentiment qui rappelle, singulièrement, l’épisode Malraux, sous la cinquième République, lorsque, pour laver l’affront et l’humiliation de l’armistice et garantir la souveraineté française sur son territoire — ce qui n’était pas évident — il exhorta les Français à un retour « nostalgique » au temps de la 1ère République et des valeurs de la «Convention», pour faire «renaître la France de ses cendres». Les évènements de Mai 68 auront raison de sa politique, en cassant toutes les hiérarchies acquises.
Le doute du Président français procède, à l’endroit du peuple algérien, de cette angoisse, notamment face à deux phénomènes inédits, dont les prolongements ne sont pas encore établis : le défilé, certes, macabre, des « harragas» algériens, qui est l’une des expressions les plus remarquables du démantèlement des territorialités nationales et le phénomène du « Hirak», une révolution populaire mature et pacifique, particulièrement citoyenne qui, au-delà de ses significations internes, a bouleversé la nature du rapport entre la France et l’Algérie.
Pour mieux s’imprégner de la problématique, il est instructif de revisiter la réplique anthologique de feu Krim Belkacem, chef de la délégation algérienne aux Accords d’Évian, à la question sur le peuple algérien : «Le peuple algérien ne renaîtra pas de la reconstitution de l’État algérien, tel qu’il a existé dans le passé. Il est une réalité constante, historique, sociologique et politique. Il est composé de tous ceux qu’on désigne communément comme les indigènes, de tous ceux qui ont résisté à la conquête française pour défendre leur liberté et leur indépendance. Il a les caractères d’une nation : l’unité de la langue, de religion, de culture. Une histoire, un destin, des souffrances, des combats communs ont cimenté une unité incontestable.»
«La guerre a montré la force de la conscience nationale et de la solidarité d’un peuple qui entend forger son destin. Mais il n’a jamais cessé de s’affranchir dans le contexte d’une continuité historique irreversible, il lui a fallu subir le fait colonial. Celui-ci s’est développé à travers l’installation d’un peuplement européen d’origine diverse mais soudé par son intégration. Dans la nation française. L’Algérie a donc été non seulement une colonie d’exploitation, mais aussi et surtout une colonie de peuplement. » (Les négociations d’Évian, 9e séance, du mardi 6 juin 1961).
C’est, encore une fois, dans le paradigme du doute que la carte mémorielle est déployée, mais cette fois-ci, pour de nouveaux découpages et une reformation de la nouvelle « Armée d’Afrique », avec ses régiments de spahis et de zouaves, sous les nouveaux habits d’une nouvelle France en marche. Le Président français, qui n’est pas historien, n’a fait que reprendre, d’une manière provocante, ce que certains de ses historiens ont déjà écrit et continuent d’écrire sur l’Algérie, pour dominer les imageries et produire de nouvelles convictions. C’est de bonne guerre pour les nostalgiques de l’Algérie française. Mais faut-il s’en dérober pour autant, quant au fond, en se confinant au rôle de la victime, en quête de soulagement et de réconfort, pour apaiser sa mémoire agressée, le temps d’une tempête, ou alors prendre le taureau par les deux cornes pour l’affronter sur l’arène du déni mémoriel ?
Un acte fondateur, par le geste et la parole, vient, en effet, d’être accompli par le ministre algérien des Affaires étrangères, exprimant un positionnement officiel, en prenant date : la reconnaissance historique et non plus mythologique et imaginaire, de Jugurtha. Le déplacement du ministre, en Italie, sur les lieux mêmes où Jugurtha a été emprisonné, torturé et assassiné, ajouté à sa déclaration : « Une pièce de de l’histoire de l’Algérie viscéralement ancrée dans le cœur de Rome. Le dernier lieu où le roi numide Jugurtha, fils de Cirta et petits-fils de Massinissa, a été emprisonné. Il y mourut en l’an 104 avant J.-C., après une guerre sans merci contre les Romains qui a duré 7 ans », sont significatifs d’une attitude politique forte, qui appelle un « arrêt sur image » et un retour sur soi, pour expurger les imprécisions, les doutes et les falsifications de l’Histoire.
Entendons-nous bien, à l’ère jugurthienne — néologisme — la géographie n’était pas réduite à de simples circonscriptions territoriales (Numidie Massyle et Massaesyle, Getulie), mais s’exprimait par la caractéristique urbaine de ses grandes villes (Zama, Cirta, Siga, Iol, Varga, Tingi, Lixus…). C’est dans la civilisation urbaine qu’il faille rechercher les éléments significatifs de la pensée numide (berbère), fondamentalement ancrée à l’espace méditerranéen.
Si sur le plan politique et économique, le monde berbère a subi les influences punico-carthaginoises et romaines, il en fut tout autrement de la pensée philosophique et religieuse. Les courants dynastiques berbères, sur la lignée de Syphax, Massinissa, Micipsa, Mastanabal, Hiempsal, Jugurtha, Juba et Ptolémée, s’inscrivaient, à des degrés divers, dans un univers culturel plus hellénistique que latinisant, établi sur un soubassement régional berbéro-punico-carthaginois assez complexe. Dans la Berbérie antique, on partageait des éléments culturels et religieux punico-carthaginois, au plus fort de la domination romaine et de l’idéologie latine. On parlait libyco-berbère et carthaginois, mais c’est dans le répertoire grec que les illustres souverains berbères ont cherché la science et le savoir, d’abord pour des considérations de prestige.
Imprégné de littérature phénicienne, Juba II écrivait en grec, il était qualifié d’écrivain grec. Ses œuvres, fragmentaires, rapportées par les anciens auteurs, comportaient des ouvrages sur l’histoire de l’Arabie, l’histoire d’Assyrie et l’histoire des Antiquités romaines. Il y figurait des ouvrages sur l’histoire de la peinture et des peintres, celle des théâtres ainsi que des traités de grammaire, de botanique. Il s’était également investi dans des recherches sur les sources du Nil et est l’explorateur des îles Canaries, entre le 25 av. J.-C et le 23 ap. J.-C., suivant les indications du Périple d’Hannon, pour y faire l’inventaire de la faune et la flore (Pline l'Ancien, Ier siècle).
De l’ordre romain païen à celui chrétien, le trait berbère permanent est cette propension à la liberté de pensée, une disposition quasi-permanente qui transparaît, d’abord, chez les empereurs romains berbères tels Septime Sévère et son fils Caracalla, ensuite chez certaines figures illustres de l’Église chrétienne, Tertullien, Aristippe et Saint Cyprien, appelant à l’établissement d’un empire chrétien universel, qui libère l’homme de toute forme de souveraineté terrestre, ne reconnaissant ni l’autorité de Rome ni celle de l’Église romaine et de ses évêques. Saint Augustin sera le sauveur de l’âme de l’Église chrétienne, au moment même où la romanité chrétienne succombait sous les assauts vandales au nom de l’Arianisme, une nouvelle théologie, d’ailleurs d’origine berbère (Arius Presbytre de l’Église d’Alexandrie), opposée au dogme trinitaire. Elle préparera le terrain à la conquête arabo-musulmane.
Il est bien établi, qu’avant la conquête arabe, et s’agissant de la sphère du savoir et de la connaissance, le monde berbère s’inscrivait, et d’une manière synchrone, dans l’espace culturel classique méditerranéen gréco-latino-chrétien, puisant des mêmes canons philosophiques, esthétiques et artistiques et de leur superposition à un fonds commun berbéro-punico-carthaginois. C’est au cours de la conquête arabe, avec l’introduction d’une nouvelle religion, l’Islam, que le paysage sociopolitique et culturel est reconfiguré, pour s’installer dans une nouvelle aire d’influence arabo-musulmane, qui va faire table rase d’un héritage millénaire, anté-islamique, exception faite de l’héritage andalousien, au plus fort du califat de Cordoue.
Les sources historiographiques arabes ont occulté l’existence d’une mémoire anté-islamique, se limitant à signaler un substrat berbère sans attaches historiques profondes. Tout est réglé sur l’horloge historiographique arabo-musulmane. L’avant appartient à la «Djahilia», monde des ténèbres. Il est surprenant que les mêmes auteurs arabes, qui avaient excellé dans le traitement de l’histoire ancienne des Perses, des Byzantins, des Romains et des Grecs, aient négligé le passé antique des Berbères. L’Islam s’est établi au Maghreb sur un hiatus mémoriel, construit sur la généalogie tribale arabo-islamique, qui a exclu toute autre forme de récit qui ne participe à l’effacement des traces, des repères et des ancrages historiques.
Pendant la colonisation française, l’Algérie a été placée entre un avant et un après, marqué par deux évènements déterminants, d’une part, la fin de la régence turque et, d’autre part, l’établissement, par la force et la violence, d’une conquête, puis d’une colonisation de peuplement.
Un nouveau rapport est établi, à la fois avec un corps étranger, occidental et chrétien (la France occupante) et un État musulman, défaillant, rattaché à l’Empire ottoman.
À l’indépendance de l’Algérie, c’est le courant indépendantiste du mouvement national, qui établira sa légitimité politique sur une identité arabo-musulmane, conçue comme socle fondateur de la nation algérienne. L’islam est érigé en religion d’État et l’arabe en langue officielle et nationale. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est le courant réformiste des «Uléma», inspiré de la pensée culturelle et religieuse de la «Nahda», qui ira rechercher les filiations profondes, pour garantir la consistance et la durabilité de la nation algérienne. L’historiographie réformiste a eu le mérite d’avoir interrogé l’Antiquité, allant jusqu’à ses soubassements préhistoriques, pour y recueillir et rassembler les matériaux de construction requis.
Rappelons-nous la charte de 1976 et ses pré requis de la doctrine révolutionnaire socialiste, tout particulièrement son titre premier qui énonçait que « l’Algérie n’est pas une création récente » [et que] « déjà, sous Massinissa, fondateur du premier État numide, et Jugurtha, initiateur de la résistance à l’impérialisme romain, s’était dessiné le cadre géographique et commençait à se forger le caractère national, qui devaient tous deux affirmer leur permanence à travers le développement historique de l’Algérie durant plus de deux millénaires. À ces deux caractéristiques principales se sont ajoutés progressivement à partir du VIIe siècle, les autres éléments constitutifs de la nation algérienne, à savoir son unité culturelle, linguistique et spirituelle, et la centralisation de son économie que sous-tendaient une rare volonté d’indépendance et un attachement indéfectible à la liberté ».
Un chapitre fondateur d’une historiographie qui garantissait la cohérence d’une histoire (temps long et temps court) avec sa géographie (au sens du territoire). Une construction historico-géographique qui sera, hélas, confondue et amalgamée — par les mêmes rédacteurs de ce chapitre – pour la situer sur d’autres significations exclusives : « Le peuple algérien se rattache à la Patrie arabe dont il est un élément indispensable » et «l’Algérie est une Nation », étant entendu que « la Nation n’est pas un assemblage de peuples ou une mosaïque d’ethnies disparates». Patrie, nation et peuple sont conjugués et combinés au gré des circonstances historiques et des entendements de chacun. Nous convenons que la notion de patrie renvoie à l’attachement patrimonial d’un peuple à son territoire, dans sa caractéristique physique, en tant que lieu vécu (étymologie du mot latin « patria », pays du père et par extension, sol natal), alors que la nation exprime une idée plus large et plus abstraite, signifiant le désir et le consentement de vivre ensemble. Pour mieux préciser sa pensée sur ce sujet, le Président feu Houari Boumediene, dans un discours prononcé à la clôture des travaux de la conférence nationale sur l’élaboration du projet de charte nationale, avait déclaré : « Nous entendons par le mot Nation, la patrie, le peuple et l’histoire », tout en soulignant que « la lutte pour dominer notre pays remonte à l’époque romaine et même avant, puis l’Algérie a fait partie de la civilisation arabo-islamique ». La notion de civilisation est introduite, ici, pour enchâsser le tout dans un creuset sans véritable fond. Nous notons, d’ailleurs, son attitude quelque peu circonspecte lorsqu’il déclara qu’« il existe certaines théories historiques disant que ce sont quelques rois berbères qui auraient contribué à l’arabisation du pays ».
Il est intéressant de rappeler, à ce sujet, le point de vue de M. Ahmed Taleb-Ibrahimi, sur la complexité des débats et discussions sur le chapitre «Révolution culturelle» de la charte nationale : «Dans nos discussions, il arrive de constater que nous ne donnons pas aux mots le même sens ; par exemple lorsqu’il s’agit de termes tels que oumma, nation, patrie, peuple. Cela est non seulement regrettable mais grave. Il arrive aussi, dans notre enseignement que l’on donne de ces mots, aux élèves, des significations qui se rattachent non pas aux orientations de la charte mais aux convictions du professeur et à la tradition dans laquelle il a été formé. » Que d’occasions salvatrices, pour rétablir les équilibres d’une histoire et d’une mémoire malmenées. Souvenons-nous de l’épisode Omdourman (Soudan), un évènement sportif anodin, où le peuple algérien est sorti dans la rue, pour manifester sa joie et réagir aux propos insultants sur son identité. En convoquant sa mémoire, il est allé au-delà d’Abane Ramdane et de Larbi Ben M’hidi et même de Syphax et de Massinissa, pour parvenir jusqu’à Chechnak, et y puiser les éléments de sa profondeur.
Rappelons ce jour du 22 février 2019, où l’Algérien avait rendez-vous avec lui-même, le temps d’un éblouissement, où le langage du sens et de la sensibilité a su produire les arrangements des cordes et des mesures pour réaliser une formidable symphonie nationale. Ce jour-là, précisément, des fibres confondues, des sentiments refoulés et des émotions ensommeillées, se sont ravivés et exprimés à l’air libre, de préférence dans la rue, pour réinventer la mémoire du lieu et rappeler ces ancrages profonds qui préservent l’honneur et la dignité d’un peuple.
C’est cet espace de communion, cet instant de rappel, qui ont été sollicités pour revisiter la mémoire, dans ce qu’elle a de plus profond et de plus prégnant, pour répondre à cet appel insistant et pressant d’une jeunesse qui veut franchir les territoires insoupçonnés de son identité, d’abord, pour expurger les imprécisions, les doutes et les falsifications, et ensuite pour affirmer et confirmer la santé d’un peuple qui a montré, le temps d’un sursaut, la teneur et la solidité de sa cohésion.
Convoquer, aujourd’hui, la personne de Jugurtha, mais cette fois-ci, en chair et en os et non plus en une production idyllique et fantasmagorique, nous commande un nouveau regard, conscient et éveillé, sur cette scène où, en l’an 104 avant J.-C., à la sortie de prison du Tullianum, sur le Forum romain, il est traîné sur le char du triomphe sous le regard mortifié de ses deux fils captifs accompagnant le cortège. C’est après lui avoir déchiré sa chemise, et ôté brutalement ses boucles d’oreilles d’or, en lui arrachant en même temps les deux lobes des oreilles, et quand il fut tout nu, qu’il sera jeté par un trou pour aboutir au cachot souterrain.
C’est dans cette prison souterraine où périrent, dans les conditions les plus infâmes, Jugurtha et Vercingétorix. Alors que le premier est rentré furtivement, voire clandestinement dans l’Histoire, pour ne plus en ressortir, le second, controversé et incarnant la «bêtise» et la «stupidité», s’est vu accorder par Napoléon III, une sculpture en cuivre de 7 m de haut, assortie d’une inscription gravée : « La Gaule unie, formant une seule nation, arrimée à un seul esprit, peut défier l’univers.»
Luttant pendant six jours contre la faim, Jugurtha sera étranglé, par ordre de Marius. Il est mort en roi numide, ayant combattu pendant sept ans la puissance romaine, entre 111 et 105 av. J.-C. Plus près de nous, en l’an 1957, conduit dans une ferme désaffectée de la Mitidja, Larbi Ben M’hidi est monté sur un tabouret par ses bourreaux, qui lui passent une corde au cou en lui bandant les yeux. Il sera pendu sur ordre du général Bigeard. Ben M’hidi est mort en colonel de l’Armée de libération nationale, ayant combattu pendant sept ans la puissante armée française, entre 1954 et 1962.
Quelle équidistance ? De Jugurtha à Ben M’hidi, de l’an 105 av. J.-C à l’an 1962, une épaisseur de sédiments à la mesure d’une Nation.
«Oui, s’il nous venait à vivre, nous défendrons vos mémoires.»
M. B.