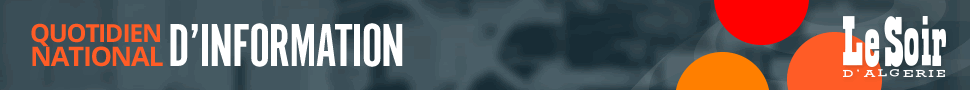Par Ahmed Cheniki
Je ne sais pas comment j’avais entendu parler pour la première fois de Fanon. Cela remonte à loin, très loin. J’ai toujours été séduit par ses positions et sa posture de révolté, ce qu’il disait de la paysannerie, de la négritude et de la lutte de libération. Mais au-delà de l’Algérie, son propos embrassait les espaces révolutionnaires de l’époque, réussissant à mettre en pièces les frontières et les murs pour proposer un autre discours, un autre langage. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que le grand économiste allemand André Gunder Frank, auteur du livre-culte Le développement du sous-développement, paru chez Maspero en 1969, a vu en Amilcar Cabral une sorte de continuateur de l’œuvre de cet homme qui, dans ses textes, Les damnés de la terre ou Peau noire, masques blancs, propose une sorte de théorie de la décolonisation. Pas uniquement, Cabral, mais tous ceux qui ont eu à cœur (en Afrique australe ou en Amérique) de remettre en question la colonisation ou de proposer un système de développement autonome, c’est-à-dire libéré des jeux de la domination. On peut citer Cabral, Nkrumah, Agostino Neto et de nombreux leaders latino-américains comme Che Guevara qui considérait Les damnés de la terre comme une sorte de bréviaire de la révolution. Le panafricanisme est au cœur du discours fanonien.
Je ne comprends toujours pas pourquoi cet homme, ce grand intellectuel, un psychiatre singulier est encore peu connu en Algérie, alors qu’il est enseigné dans les plus grandes universités du monde, surtout aux Etats-Unis. Alors qu’en 1961, il était gravement malade, il avait refusé de se faire soigner à Washington. Il eut fallu de sérieuses pressions pour qu’il accepte, mais en avançant une condition : être enterré en Algérie.
C’est ce qui fut fait. Ils étaient quelques-uns à accompagner sa dépouille à la frontière algéro-tunisienne. Pierre Chaulet s’en souvenait, lui qui l’avait bien connu, notamment à Tunis, mais aussi à Blida : «Oui, nous étions partis, escortés par des combattants en armes, le soir, entre la Tunisie et l’Algérie, nous lui avions fait les honneurs avant de l’enterrer. On avait entonné l’hymne national. C’était extraordinaire. Fanon avait toujours été un homme très courageux, ferme, qui avait des positions parfois tranchées. Ce qu’il avait fait à Blida était extraordinaire.» Tout avait été fait dans le respect de l’homme qui connut une vie extraordinaire.
Je l’imagine chez lui à Fort-de-France, très content de lui, se satisfaisant d’une vie peut-être morne, mais qui ne le mécontentait pas du tout, surtout qu’il est issu d’une famille moyenne. Son père était inspecteur des douanes et sa mère, Alsacienne, tenant une boutique, ce fils de descendants noirs, esclaves venus d’Afrique, avait tout pour vivre très bien sans ces attitudes peu amènes marquées d’une sorte de racisme vécues paradoxalement dans la période de la résistance. En 1943, il s’engagea dans la résistance, aux côtés de De Gaulle, dans l’armée de libération de la France. C’est là, blessé, qu’il prit conscience de la discrimination raciale et ethnique qui caractérisait les attitudes de nombreux résistants. Il comprit ainsi que ses lectures ne pouvaient correspondre au monde concret. Beaucoup d’amis ont proposé des témoignages sur cette période de questionnement et de désenchantement vécu par Fanon. «Au départ, disait un de ses amis, il n’arrivait pas à saisir ces comportements racistes qui pervertissaient tout le discours de la résistance. C’est à partir de ce moment qu’il eut une sorte de libération lui permettant d’interroger les savoirs européens.»
Ainsi, il rompit avec cette image de l’Européen qu’il portait comme une valise, notamment à l’école où il reprenait avec insouciance ce slogan devenu subitement suspect : «Nos ancêtres les Gaulois.» L’égo retrouvait l’Autre, l’explorateur, le colonisateur, le blanc qui n’est plus désormais lui. Il se disait peut-être qu’il était un descendant d’esclaves, il savait désormais que le regard porté sur les Noirs est resté toujours prégnant. Lui, fils de Fort-de-France (Martinique), il allait revisiter le corps du colonisé à partir duquel il se mit à explorer l’anatomie du colonisateur. Déjà, en 1945, il se lançait dans la politique alors qu’il s’en éloignait, lui le petit-bourgeois qui estimait que ça ne l’intéressait pas. Il soutint fermement durant les élections législatives son ancien instituteur, Aimé Césaire, connu pour ses idées indépendantistes et son opposition au colonialisme. Son «discours sur le colonialisme» reste encore un livre de chevet de très nombreux résistants, comme d’ailleurs son œuvre poétique et littéraire. Il comprit que le combat des acteurs de la négritude était, au départ, légitime. «Oui, renchérit Josie, toujours le sourire aux lèvres, il n’a jamais considéré que la négritude était un mouvement contre-révolutionnaire. Il estimait que si, au départ, il était porteur de valeurs positives et était légitime, par la suite, les choses ont changé, le noir se mettait à exploiter le noir, notamment après les indépendances, alors que l’important devenait le social. Mais il faut savoir qu’il avait beaucoup de respect et d’admiration pour Aimé Césaire qui développait un autre discours par rapport à Senghor qu’il n’estimait pas beaucoup, le considérant comme le représentant attitré de la France.»
Josie qu’il épousa en 1952 parle avec une grande émotion de cet homme volcanique, extrêmement passionné et entier. Elle est d’une finesse extraordinaire et d’une grande générosité. Amie de Bachir Rezzoug et de la moudjahida Mimi Maziz, des collègues à Révolution Africaine, elle évoque Fanon en prenant de la distance. «Il était, disait-elle, très affectueux et très attentionné.» Même Olivier, son fils, parle avec un incroyable détachement de ce père qui, dès le départ, appartenait à plein de monde et à de nombreuses causes. Olivier, se plaît à dire Josie, c’est le portrait de son père, il plaisante beaucoup et n’arrête pas de rire, même de lui-même. Son père, Frantz Fanon, est une propriété publique, un bien commun, il est revendiqué un peu partout dans le monde. Olivier comme Mireille qui épousa le fils de Mendès-France savent que leur papa qui les chérissait énormément est aussi la propriété d’autres causes. Josie se tait pendant de longues minutes, ne bronche pas, comme si elle se remémorait les moments passés avec cet homme-roseau. Elle réfléchit, puis parle : «Il était beau, il ne tolérait pas l’injustice, quelques pointes de colère, il aimait discuter, débattre de questions sérieuses, il riait aussi beaucoup, ses amis de Tunis, les Chaulet qui étaient fabuleux. Rédha Malek, M’hammed Yazid, El- Mili… en savent quelque chose.»
Mohamed El-Mili qui dirigeait la version arabe d’El Moudjahid m’en fit un portait élogieux : «Il était d’une grande modestie, tout le monde savait qu’il avait énormément apporté à la cause algérienne. Lui-même était conscient de ce que lui avait insufflé la Révolution. Il animait, en dehors de ses articles, des séances de formation politique très appréciées par les militants et les cadres. C’était un être et un intellectuel exceptionnel. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison qu’il participait souvent au nom du Front à de nombreuses rencontres comme celle d’Accra et qu’il avait été nommé comme délégué permanent du GPRA au Caire, à Accra, au Congo, au Mali, en Angola et à l’ONU, à New York.» Josie rit encore, s’arrête un moment, fixe un point précis du mur en face, tourne et retourne ses doigts, égrène quelques souvenirs et se met à évoquer certains points de la vie de Fanon tout en insistant sur le fait qu’il n’est nullement possible de comprendre son parcours si on ne fait pas appel à tous les lieux importants et les rencontres qui ont marqué son itinéraire : «C’est vrai qu’il eut un véritable choc en étant confronté au racisme et à la discrimination dans un espace qui aurait dû être celui de la liberté et de l’ouverture, lui qui avait vécu une situation stable, puis le discours prétendument scientifique de certains psychiatres et anthropologues qui épousaient et justifiaient le discours colonial allaient transformer sa conception du monde et sa vision de la psychiatrie en tenant compte des conséquences de l’exploitation coloniale sur l’état mental et social du colonisé.»
Je comprends vite que pour saisir cet homme, il faudrait interroger tout son parcours, lui qui s’assimilait au Blanc au moment où les chantres de la négritude mettaient en œuvre un discours qui fustigeait le Blanc. Que ce soit dans les revues L’Etudiant noir, Légitime défense ou Tropiques, ces jeunes poètes antillais et africains, Léon-Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor ou dans leurs textes poétiques, ils donnaient à lire la nécessité de la résistance. C’est au moment où il s’y attendait le moins qu’il fut confronté au racisme, à sa situation de colonisé, de l’Autre, durant son engagement dans la résistance aux côtés des forces antinazies. Tout cela va déterminer ses choix futurs et aussi, peut-être, ses ambiguïtés, ses contradictions. Ses années à la faculté de médecine allaient lui permettre de faire des rencontres qui allaient compter dans sa formation. Olivier, toujours souriant, des gestes désordonnés, parle de son papa avec simplicité : «Mon père avait été très affecté par les différentes discriminations, il ne pouvait passer outre les attitudes racistes de certains enseignants et de psychiatres qui justifiaient une certaine supériorité des Européens.» Oui, ce que dit Olivier va être développé par Pierre Chaulet, un grand médecin, qui connut Fanon à Blida et à Alger qu’il fréquentait assidument à Tunis, raconte avec émotion : «Fanon était d’une grande curiosité scientifique. Pour lui, tout était à interroger. Il a consolidé ses choix dès qu’il avait été affecté à Blida en 1953 comme médecin-chef à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. La rencontre de ses premiers patients fut un choc. Il comprit que le fait colonial était important dans la maladie. C’est ainsi qu’il adapte des méthodes de sociothérapie aux patients colonisés. Il va se mettre à faire un travail de désaliénation.»
Tout cela est important pour Fanon et son désir de réinterroger l’appareillage conceptuel et la relation avec l’Europe. Il va être confronté à une redéfinition de l’altérité et d’une Europe qui use d’un discours de liberté alors qu’elle pratique la colonisation. Pour lui, comme pour son instituteur, Césaire, le colonialisme est un mal intégral. Il le déclare sans détours : «La colonisation est une négation systématisée de l’Autre, une décision forcenée de refuser à l’autre tout attribut d’humanité.»
Le colonisateur apprend la docilité à l’indigène, le met en cage et lui inculque un sentiment d’infériorité et d’enfermement. Ce qui provoque chez le colonisé une certaine propension à la liberté dans ses rêves et ses songes, mais aussi une certaine violence contre les siens. Fanon en parle ainsi : «La première chose que l’indigène apprend, c’est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites ; c’est pourquoi les rêves de l’indigène sont des rêves musculaires, des rêves d’action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j’éclate de rire, que je franchis le fleuve d’une enjambée, que je suis poursuivi par une meute de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n’arrête pas de se libérer entre neuf heures du soir et six heures du matin. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va d’abord la manifester contre les siens. C’est la période où les nègres se bouffent entre eux et où les policiers, les juges d’instruction ne savent plus où donner de la tête devant l’étonnante criminalité nord-africaine.»
Fanon rit sous cape, fait un pas en avant, se frotte les mains, parle avec son patient en arabe, parce qu’il a eu le temps d’apprendre la langue, le regarde, sourit, il semble anticiper tous ses gestes, scrute ses mouvements, il sait aussi qu’il doit se libérer de ce complexe d’infériorité et de peur que lui a instillé le colonisateur. Il connaît bien son patient, d’autant plus qu’il a cherché à comprendre les myhes, les rites et la culture des Algériens. Abderrahmane Aziz a les larmes aux yeux quand il évoque celui qui va choisir le prénom d’Ibrahim Omar durant la lutte de libération : «C’était un homme singulier, d’une bonté et d’une générosité légendaires, un grand psychiatre qui m’appelait pour chanter, apportant aux patients une certaine joie. J’ai été, au départ, invité par le Docteur Fanon pour égayer les malades à l’occasion d’une fête qui s’était très bien passée à tel point que les malades s’étaient mis à répéter avec moi les mots de la chanson Ya kaaba ya bit rabbi. Ainsi, je devenais un acteur de la psychothérapie institutionnelle.
La musique devenait une véritable thérapie grâce à Fanon.» Fanon appréciait Abderrahmane Aziz, aimait discuter avec lui parce qu’il cherchait à comprendre la société algérienne. C’est vrai que Fanon avait déjà rompu avec la méthode traditionnelle de la psychiatrie. Il ne pouvait pas admettre le fait d’enchaîner les malades. Déjà, dès sa première affectation dans un hôpital psychiatrique de Normandie, il commença à pratiquer une thérapie sociale, respectant les malades. Il fut mal jugé, considéré comme peu apte à assumer sa fonction.
C’est vrai qu’à l’époque dominait une médecine très conventionnelle. A Alger, il eut plus de liberté, malgré l’opposition de beaucoup de ses confrères qui n’admettaient pas cette manière de faire qui accordait une certaine liberté aux patients qui, ainsi, retrouvaient une certaine posture sociale.
Josie fulmine contre les idées racistes et les discriminations, elle est rouge de colère, se tait, respire un coup, puis se lance dans une sorte de cours. Mimi Maziz, notre collègue à Révolution Africaine, ancienne poseuse de bombe à Alger, durant la bataille d’Alger, est aussi de la partie, soutient l’épouse de Fanon : «Dès qu’il a compris l’origine du mal, la dimension sociale et coloniale, il a trouvé une autre manière de soigner les malades. Ce n’était pas facile. A l’époque, l’école d’Alger dominait. Fanon qui s’opposait fortement à l’école algérienne de psychiatrie présidée par Antoine Porot qui reprenait l’idée de Gobineau sur l’infériorité des races mettait en relation l’action politique et l’acte psychiatrique.» Fanon humanise la psychiatrie, s’en va-t-en-guerre contre les idées de Lévy-Bruhl et d’Olivier Mannoni qui justifiaient l’inégalité des races. Il réussit à déconstruire leur discours et à mettre en pièces leurs affirmations soutenues par des positions idéologiques. Le livre de Mannoni, Psychologie de la colonisation (Paris, Le Seuil, 1950), qui porte un regard négatif sur le colonisé, a fini par faire sortir de ses gonds Fanon qui comprit vite que ces lectures dites scientifiques n’étaient en fin de compte que des constructions idéologiques. Sa thèse présentée au début des années cinquante, qui allait être publiée, par la suite, sous le titre «Peau noire, masques blancs» est vite refusée parce que le sujet avait été considéré comme tendancieux. Les protecteurs du temple ne pouvaient laisser passer une thèse donnant à lire les méfaits du racisme et du colonialisme. Il fut obligé de changer de thème.
Le colonisateur construit son colonisé, le dévalorise, le déshumanise et finit par le massacrer. C’est ce qu’il écrit dans son livre-testament, Les damnés de la terre, écrit à la va-vite parce qu’il savait qu’il allait mourir : «Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler de l’homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre.» C’est vrai que, parfois, cette opposition que nous retrouvons chez Fanon entre une Europe perçue comme une totalité et le tiers monde pose problème, évacuant les contradictions et la dimension plurielle des sociétés. Mais c’est vrai aussi quand il s’agit de racisme, il nuance son propos : «Le Noir qui veut blanchir sa race est aussi que celui qui prêche la haine du Blanc.»
Fanon qui déconstruit le discours colonial, insistant sur la frontière flasque entre la subjectivité et l’objectivité tout en n’arrêtant pas de soulever la question de la porosité du discours scientifique lisait énormément, touchant à tout, Merleau Ponty dont il fréquentait les cours à Paris, Lévi Strauss, Sartre, Mauss, Heidegger, Lacan, Marx, Lénine, Hegel…
Il aimait par-dessus tout la littérature. Hemingway, Faulkner, Kateb Yacine, Mohammed Dib, Césaire, Fodéba ne lui étaient nullement étrangers. Pierre Chaulet parle avec une grande passion de son ami, surtout quand il s’agit de littérature. «Je discutais souvent avec Fanon sur des textes littéraires, il lisait de tout, sociologie, littérature, histoire. C’était quelqu’un qui lisait et analysait en même temps ses textes. Je ne pouvais pas l’imaginer sans livres.» Il aimait énormément Jean-Paul Sartre. Il a toujours voulu le rencontrer, ce qui fut fait à Rome en 1961. Fanon ne tenait pas en place, il allait enfin discuter avec Sartre, en présence de Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann : «C’était inimaginable, disait Fanon, jamais je n’avais pensé discuter ainsi avec Sartre, ce fut un rêve, il m’écouta avec une grande attention. Je lui avais demandé de me préfacer Les damnés de la terre. C’est vrai que déjà Claude Lanzmann que je connaissais bien lui avait parlé de la préface.» Sartre et De Beauvoir furent conquis par cet homme de principe, d’une exceptionnelle culture, d’une parfaite érudition. Josie se rappelle ces moments de grande joie de son mari qui écrivait à l’époque Les damnés de la terre dont il tentait d’achever rapidement la rédaction parce qu’il savait qu’il n’allait pas résister à ce maudit mal qui allait le terrasser. Elle semblait réfléchir, cherchant les mots, pensant à cet homme, son homme qui allait quitter ce monde, trop jeune, à l’âge de 36 ans. Quelle injustice ! pensa t-elle à voix trop peu audible, comme si soliloquer restait le langage convenu pour évoquer cette injustice frappant un homme qui, en très peu de temps, réussit la gageure de secouer le cocotier intellectuel. Elle parle, mais je ne sais pourquoi le soliloque vient à la rescousse de la discrétion quand il s’agit d’évoquer leur vie intime. Déjà, avait-il une vie intime, lui dont les travaux interpellaient le monde entier et mettaient en pièces le discours colonial. Josie reprend la parole, des propos épars, un discours disséminé, des phrases-lambeaux, revient en arrière, des va-et-vient incessants, évoque le passage à Tunis et au FLN : «Dès son arrivée à Alger en 1953 et ses rencontres avec les malades autochtones, il se rendit compte des méfaits de la colonisation. C’est ce qui l’incita d’ailleurs à déposer sa démission de médecin-chef avant d’être expulsé vers la France en 1957. Quand il exerçait à Blida, il lui arrivait de retrouver Abane et Ben Khedda lors de ses déplacements à Alger. Il rejoignit Tunis et collabora essentiellement à Résistance algérienne et El Moudjahid. Il était d’une grande curiosité, il apprit l’arabe. Il participait à de grands congrès internationaux comme celui d’Accra par exemple.»
Il rit encore, cette fois-ci d’une mort annoncée qui ne vint pas, il rigole, rit d’une fin suspecte faite de tentatives d’attentats qui ne réussirent pas à briser sa détermination et à arrêter cet homme très proche des petites gens et très ouvert aux grands débats.
La Main rouge, un groupe criminel d’extrême droite, fit tout pour mettre un terme à la vie de cet homme qui n’avait que mépris pour le colonialisme qui est un mal intégral rejoignant ainsi son enseignant, Aimé Césaire qui écrivait presque la même chose. Fanon ne recule pas, avance, aime discuter, il sait qu’il est menacé, ses idées ne pouvaient plaire à ses ennemis, leur arme, la mort, il le sait, même quand il fut victime d’un accident de la circulation en 1959, des nervis ultras, la vermine, tentèrent même de l’assassiner à l’hôpital. Il éclate de rire, puis un moment de colère en se souvenant de ce moment passé à Tunis comme psychiatre dans un hôpital de Tunis, à la Menouba, où le directeur de cet établissement, un petit inconnu, un imbécile, un Tunisien, n’hésitait pas à l’appeler le «négro». C’est Albert Memmi qui a raconté cette histoire qui rend compte de la petitesse et de l’indignité de certaines personnes. C’est pour dire que le racisme est un mal ancré dans toutes les sociétés, notamment nord-africaines et arabes. Fanon le sait, il n’a que mépris pour ce petit qui n’a plus de nom, il continue son chemin, ne reconnaît pas la validité de la notion de race, ni de civilisation. Il sait comme Claude-Lévi Strauss qu’il n’y a qu’une seule race et une seule civilisation, la civilisation humaine. Edgar Morin défendra quelques décennies après cette idée dans un monde qui semble avoir abandonné l’homme perdu, égaré dans les interstices de la puissance.
Le colonialisme est la négation de l’homme, Fanon est aujourd’hui présent parmi nous, qui, dans ses écrits, a insisté sur les dangers du discours colonial dont les traces marqueraient profondément le corps de pays apparemment indépendants.
Le psychiatre qui a eu le temps d’observer le processus de décolonisation de 1960 en Afrique ne se faisait nullement d’illusions sur l’Afrique des indépendances de pays traversés par une certaine «malédiction» et une mauvaise gestion. Il écrivait déjà dans Les damnés de la terre ces propos prophétiques : «Disons-le, nous croyons que l’effort colossal auquel sont conviés les peuples sous-développés ne donnera pas les résultats escomptés.» Paroles, certes, prémonitoires, mais résultat d’une fine analyse de la situation des mouvements de décolonisation en Afrique, en passant par une violente critique de la négritude et de l’Europe qui continuerait à exploiter les richesses des colonies tout en fustigeant l’Afrique encore prisonnière du colonialisme : «Les nations européennes se vautrent dans l’opulence la plus ostentatoire. Cette opulence est littéralement scandaleuse car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, elle s’est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développé. Le bien-être et le progrès de l’Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes.»
Fanon le savait, le sait, le monde n’a pas réellement changé, les guerres contre les peuples sont désormais enveloppées dans une sorte de linceul affublé du sceau revisité de la démocratie et des droits de l’homme à géométrie variable, les structures transnationales sont des coquilles vides justifiant le plus souvent les désirs des plus puissants. Il fulmine des reproches contre l’ONU, il bouge ses mains avant de lancer avec véhémence : «L’ONU n’a jamais été capable de régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme par le colonialisme, et chaque fois qu’elle est intervenue, c’était pour venir concrètement au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. En réalité, l’ONU est la carte juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute a échoué.» Le «paraclet» (intercesseur, protecteur) comme l’appelait Aimé Césaire, sait que l’histoire du rapport du colonisateur et du colonisé ne risque pas de changer rapidement. Le colonisateur construit son colonisé, lui impose son propre regard à tel point qu’il se regarde à travers sa propre lorgnette. Le colonisé module sa propre aliénation. C’est ce que Fanon appelle «complexe du colonisé» qui fait du colonisateur un modèle. Edward Saïd a bien saisi cette réalité en insistant sur le fait que le regard de l’«Occident» sur nous-mêmes n’est qu’un «regard du dehors», résultat d’une longue histoire de colonialismes.
Josie qui meurt le 13 juillet 1989 observe un long mutisme, remue sa tête, pose ses mains sur une table nue, regarde loin, jette un clin d’œil amical à Mimi Maziz, puis se lève, toujours silencieuse, se met à parler de la critique des dirigeants africains et des bourgeoisies «gérantes des entreprises de l’Occident», du panafricanisme cher à son mari et de la notion de peuple dont on a perverti le sens. Elle ne comprend pas pourquoi Fanon qui est enseigné dans les plus grandes universités du monde semble peu présent en Algérie, dans son pays. Il est partout revendiqué, notamment par les spécialistes des études postcoloniales qui en font leur porte-drapeau. Je me souviens de ces témoignages à Alger lors du colloque organisé par l’hebdomadaire Révolution Africaine en 1987 à Riad-El-Feth et de nombreuses rencontres à Tarf, grâce à l’ami Slimane Djouadi. Il y avait du monde, d’anciens amis, des témoins, des universitaires. Je me souviens encore de ces larmes de Rédha Malek en me parlant de celui qui apporta énormément à la révolution, de ce regard fermé de Mohamed Saïdi et de Mohamed El-Mili, de Bouhara, de M’hammed Yazid, de Chaulet ou même Bouteflika, présent à Riad-El-Feth qui ne cessa d’égrener les qualités de Fanon et de son maître-livre, Les damnés de la terre de Manville ou de Ngandu Nkashama, tous, et ils étaient nombreux, ils étaient là. Mais franchement, je préfère de loin ces rencontres sans grands moyens de Tarf au colloque d’Alger, trop étouffant. Simone de Beauvoir parle ainsi des derniers instants de cet homme qui l’a profondément marquée par son intelligence et sa pugnacité dans son ouvrage, La force des choses : «Cette nuit, disait-il à sa femme peu de jours avant sa mort, ils m’ont mis dans la machine à laver.»
A. C.