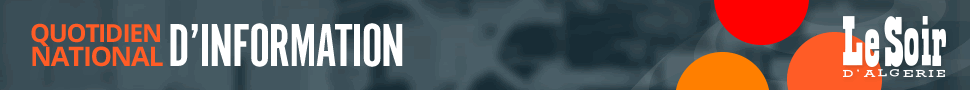Par Amar Belkhodja(*)
Que Maâchi exerça la fonction de technicien à Radio-Alger, nous pouvons considérer cela comme une véritable aubaine. C’est une telle fonction qui va lui permettre d’enregistrer une partie de l’œuvre musicale sur bande magnétique. Aujourd’hui, il faut admettre que c’est une véritable opération de sauvetage qui nous aura permis d’écouter et d’apprécier une partie d’une œuvre musicale si importante par rapport à une carrière relativement courte d’un talentueux auteur-compositeur-interprète que fut le jeune Maâchi. Ali Maâchi devenu célèbre dans les milieux de la chanson, c’est la maison Pathé qui lui propose, en 1955, la production de disques.
Il refuse, confiant à son ami Mokhtar Okacha, que l’Algérie étant en guerre contre le colonialisme français, le moment était mal choisi pour aller enregistrer des chansons alors que le sang des Algériens arrosait le sol de la patrie.
C’est par Ya babour que Ali Maâchi entre sur la scène artistique. Une composition dédiée à la mer et à la dulcinée restée sur les bords d’une autre rive, seule avec ses rêves et ses espoirs qu’un jour viendra lui rendre son amoureux. C’est avec cette belle chanson que Maâchi et son orchestre Safir Ettarab se produisent pour la première fois à Oran. Le manque d’archives ne nous permet pas de situer avec exactitude la date du premier exploit du groupe tiareti. Cela se passe probablement en 1953. C’est à l’occasion de l’inauguration d’un théâtre. Dans la salle, se trouve un futur maître de la chanson algérienne : Blaoui Houari. A la fin du spectacle, public et monde artistique de la place oranaise sont épatés. Maâchi et ses camarades sont une véritable révélation.
La presse locale leur rend l’hommage qu’ils méritent et considère Maâchi comme un élément capable de rivaliser avec les célébrités de l’époque.
D’autres compositions suivront. Comme il porte l’Algérie dans son cœur, Maâchi dédie une belle chanson à l’Algérie et à sa jeunesse : Taht sama El-Djazaïr. Cette composition sur un ton gai et alerte deviendra l’hymne de toute la jeunesse de l’époque, comme elle sera également reprise par Mohamed Lamari. Elle est composée sur le mode âdjem (do majeur), associé à une rythmique de marche. Son répertoire comprendra Ya dhak el youm fel ‘chya kinetfakrek ma nensach (mode mekriz). Une très belle qacida par laquelle il évoque son propre drame. Sa propre histoire. Une grande histoire d’amour entre deux époux qui furent séparés pour des raisons extraconjugales, cultivées et amplifiées par une mésentente entre les familles alliées. Ya dhak el youmfel ‘chya est une véritable qacida qui retrace les souffrances d’un couple déchiré et qui ne comprend pas pourquoi leur amour est sacrifié par des préjugés et un comportement qui font fi du très fort sentiment qui lie un homme à une femme, légitimement mariés. Une qacida par laquelle on ressent le sort et l’état de désespoir de Mâchi, celui de ne plus revoir la femme de sa vie, l’aimer et vivre avec elle.
Un amour vite rompu, alors qu’il venait à peine de naître, nous dit Maâchi qui décrit avec passion cet amour. Une qacida qui mérite d’être attentivement écoutée. Elle nous aidera à mieux ressentir les souffrances d’un homme. Maâchi ne se remettra jamais de cette séparation. Ses amis nous racontent qu’il se rendait assez souvent seul dans le local des répétitions à Tiaret pour mettre sur partition le long texte qu’il avait écrit pour parler de sa propre souffrance, de son propre chagrin. Maâchi, un grand amoureux d’une femme, une seule : son épouse. De 1953 à 1955, une chanson succède à une autre. Maâchi se prédestinait à devenir une véritable école. Dans une courte carrière, il compose (textes et musique) une chanson à un autre rossignol du djebel G’zoul : Larbi Hachemi, dit Oueld El Garde. Un véritable émule de Farid El-Atrache. Fermez les yeux et écoutez, disait-on à l’époque, vous aurez cette impression d’entendre Farid El-Atrache chanter.
Le génie de Ali Maâchi, c’est d’être capable de signer une création musicale sur une naghma orientale. Comme il a été capable de nous faire survoler l’Algérie avec Angham El-Djazaïr faisant montre de la maîtrise qu’il avait des différents modes et genres musicaux propres à chaque région. Il s’agit de Ya salam ‘alal banat que le talentueux Larbi interprétera avec brio. Avec cette composition, Larbi, le Farid El Atrache tiareti, n’est pas désorienté.
La chanson correspond merveilleusement à son timbre. Il l’interprète avec passion et enthousiasme. Le maître n’a pas eu trop de difficultés à convertir le jeune chanteur de la troupe et contrer l’influence de la chanson égyptienne. Cette chanson remporte un grand succès. Dans tous les spectacles artistiques et célébrations de mariage, elle est réclamée avec insistance.
Ali Maâchi élargit son chant artistique en composant un texte pour un autre interprète de la chanson algérienne : Mohamed Tahar le Mostaganémois. Il s’agit de Essayf Oussal. L’œuvre de Maâchi, répertoriée et enregistrée, comprend également : Mazal ‘alike nkhamem ainsi que Ouassit el goumri qui fut reprise par Djilali Deramchi sur un mode mekriz. Mais la plus belle de toutes, l’œuvre maîtresse de Ali Maâchi, fut et demeure, sans conteste, Angham El Djazaïr dont le refrain qui met en avant l’amour de l’Algérie est composé sur le mode bayati. œuvre qui survivra à son auteur en devenant un véritable hymne national par sa diffusion assidue à toutes les fêtes nationales post-indépendance. Maâchi eut le talent de réussir, sans lasser l’auditeur, dans un enregistrement qui dure une quinzaine de minutes environ, une composition musicale qui rassemble les principaux genres qui caractérisent le patrimoine de l’Algérie. Les textes de Maâchi ne sont pas trop savants. Les paroles sont simples et perspicaces à la fois. Elles sont inspirées du terroir et vont droit au cœur et à l’esprit. Nous avions souligné plus haut que Maâchi jouissait de prédispositions qui l’auraient imposé comme une véritable école de la chanson algérienne. Angham El Djazaïr en est une preuve concrète puisque l’auteur, originaire des Hauts-Plateaux (djebel G’zoul, Tiaret), nous démontre, par cette œuvre, qu’il était capable d’incarner l’ensemble — ou presque — des genres musicaux. Ainsi, dans Ahgham El Djazaïr qui est d’abord et avant tout un amour que l’auteur exprime à sa patrie, Ali Maâchi nous prend par la main et nous invite à la découverte de l’Algérie, du peuple algérien, à travers des airs charmants et mélodieux qui appartiennent chacun à une région : l’Oranie où la chanson dite bédouine est prédominante avec les Hamada, les Khaldi et les Abdelmoula. Ce couplet est composé sur le sabazemzem, un mode propre à la chanson traditionnelle avec flûte et galal (tambourin).
Le Sahara, en mode bayati, si envoûtant par ses espaces, ses îlots de verdure, ses dunes qui dansent au gré du vent et son hospitalité légendaire ; la Kabylie en mode bayati, avec son rythme frénétique et dont les vertus sont évoquées par l’auteur-interprète ; Constantine, la ville de Sidi Rached, et de conclure par Alger la Blanche qui a séduit tant de cœurs dont celui de Maâchi lui-même. Ainsi se résume le «cadeau musical» offert à l’Algérie et aux Algériens. Un cadeau musical qui, telle une colombe qui vole dans les airs, traverse le pays et fait déverser sur chaque région qu’elle survole des milliers de confettis de toutes les couleurs dont chacun recèle une note, une naghma propre à chaque espace traversé. Angham El-Djazaïr, un bel hommage rendu par Maâchi à la diversité culturelle, à la richesse du patrimoine, à la beauté de l’Algérie. Somme toute, une œuvre diverse et unificatrice à la fois, mise au service de la fortification de la personnalité algérienne. Un succès musical mais aussi une réponse la plus élégamment artistique à la France coloniale qui avait mis tous les moyens pour anéantir l’histoire et tous les constituants de la personnalité du peuple algérien.
L’indépendance recouvrée, Angham El Djazaïr intéresse plusieurs interprètes et compositeurs algériens. C’est d’abord Nora qui donne le ton en interprétant, la première, le refrain et tous les couplets de l’œuvre. Deux autres compositeurs, et non des moindres, Blaoui Houari et Cherif Kortebi livreront, chacun selon son style et son expérience, de très beaux arrangements à l’œuvre confiée à une pléiade d’interprètes. A Tiaret, c’est Safir Ettarab qui perpétuera le répertoire de Ali Maâchi dont l’interprète attitré n’est autre que Mohamed Benblidia, Mohamed Fateh pour la place d’Oran.
D’autres amateurs taquineront d’une manière assidue le répertoire de Maâchi. C’est Mohamed Kerkouba qui eut un faible pour Zahyene ou labès et Abderrahmane Meghazi, sans se faire marin, ne cessait de reprendre sa chanson préférée, Ya babour. C’est également Mohamed Marocain, l’interprète de la célèbre Rachda, qui est venu à Tiaret après l’indépendance, où il a rendu un hommage à Ali Maâchi par une chanson qu’il a composée et interprétée.
Il fut invité à un gala artistique organisé par la troupe Nasr Echabab, dirigée à l’époque par Mustapha Belarbi. Aucune trace de cette chanson. Personne n’a eu la présence d’esprit de l’enregistrer ou de la transcrire. Rappelons toutefois que ounchoudet Rachda était pour Mohamed Marocain ce que Hiziya était pour Abdelhamid Ababsa ou Ras B’naddem pour El-Bar Amar.
D’émouvantes qacidate qui ont fait le tour d’Algérie et du Maghreb pendant les années cinquante.
C’est le même Safir Ettarab des belles années de l’indépendance qui continuera à exécuter, en ouverture, un morceau de musique Terig Ouahran, une composition méconnue aujourd’hui que Maâchi n’avait pas enregistrée à la radio et qui risque de disparaître à jamais si l’on ne prend pas le soin de la reprendre avec la contribution des anciens musiciens de Safir Ettarab.
Une composition musicale qui risque de connaître le sort de toutes les autres chansons non disponibles sur les bandes magnétiques de la radio et que Maâchi interprétait en diverses occasions lors de sa courte carrière artistique. Certains de ses compagnons d’art se remémorent les titres de ces chansons mais sans se rappeler les airs sur lesquels furent composés les textes de Maâchi, à l’exception de Zahiyne ou labès (bayati) qui égayait les cérémonies de mariage dans la capitale du G’zoul, grâce aux chanteurs locaux Mohamed Benblidia et Mohamed Kerkouba. Le répertoire de Maâchi dont on ne connaît que les titres se compose comme suit : Ya chabha el hlal, Errabiî, Nedjmaoua Hlal, Ramadhan, Ziaret sidi Khaled. L’épouse de Maâchi est toujours présente dans cette œuvre.
C’est toute la richesse d’un répertoire amputé malheureusement d’une importante partie, certes, que nous a offert le martyr du 8 juin 1958. L’oubli est en train de menacer d’autres chansons écrites et reprises par les chanteurs locaux après l’indépendance. Elles ne font pas partie du répertoire disponible actuellement à la radio. Il s’agit notamment de Zahyene ou labès, Ya salamala l’banat et Ya babour. Leur reprise par un orchestre serait salutaire. Elles pourraient alors être ajoutées aux archives sonores de la radio. La Fondation qui porte le nom du martyr, créée en 1997, à Tiaret, dont nous avons été les initiateurs et rédacteurs des statuts, a formulé plusieurs propositions dont certaines ont abouti. Ainsi par exemple, la journée du 8 juin, date de l’assassinat de Ali Maâchi par les Français en 1958, fut décrétée par le ministère de la Culture Journée nationale de l’artiste.
La première commémoration eut lieu en 1998. De même que la présidence de la République a institué le prix Ali-Maâchi qui est décerné annuellement à la meilleure création artistique.
C’est grâce à cette journée que des sites de la ville d’Oran furent baptisés aux noms de Ahmed Wahbi et Sirat Boumediène. Que cette initiative soit propagée à travers les autres villes du pays. Il resterait cependant, pour immortaliser l’œuvre du martyr Maâchi, la reprise de l’ensemble du répertoire par les meilleurs interprètes de la chanson algérienne, les meilleures voix masculines et féminines du meilleur amour de Maâchi : l’Algérie. Par une telle initiative, on maintiendra le trait d’union artistique entre les générations. En même temps, c’est aussi le meilleur hommage que l’on puisse rendre à celui qui aima et chanta l’Algérie et qui se sacrifia pour elle. La célébration de la Journée de l’artiste, dont l’idée naquit à Tiaret, comporte, par voie de conséquence, deux acquis. Le premier est celui de la mémoire.
Le 8 juin de chaque année, c’est la postérité qui abreuve sa mémoire et cultive le souvenir du sacrifice de l’artiste martyr, de tous les artistes qui ont défendu l’idéal de la liberté. Mohamed Touri est arrêté par l’armée française et succombe aux tortures. Blaoui Houari est plusieurs fois persécuté par les autorités colonialistes. Ababsia, né en 1936 à Souk-Ahras, est un musicien et martyr méconnu. C’est grâce au travail de chercheur assidu de notre ami Abdelkader Bendamache que nous apprenons que Ababsia est arrêté, torturé et assassiné le 10 octobre 1958 par les colonialistes français qui se refusaient à cette évidence que l’Algérie ne leur avait jamais appartenu et ne pouvait, après le grondement de novembre 1954, jamais leur appartenir. Le second acquis que nous comptabilisons le 8 juin de chaque année, c’est de pouvoir faire le bilan de la promotion des arts dans notre pays puisque les disciplines artistiques sont les repères tangibles de la civilisation, des avancées de la civilisation. Elles nous révèlent les signaux qui nous indiquent si cette civilisation est une phase de progrès ou de déclin. C’est aussi une journée qui donne chaud au cœur à toute la corporation – elle est si grande et si symbolique – des artistes qui aspirent à une place plus honorable et plus digne dans une société qui, autrefois, vénérait ceux qui rendaient son existence supportable, agréable. Une société qui avait fortement applaudi Allalou, Touri, Fadhila Dziria, M’rizeq et El Anka, Sonia et H’lilou, Medjoubi et Alloula, Abderrahmane Aziz et Laâchab et tant d’autres. Femmes et hommes ont choisi des mélodies, des planches et des plateaux, des mots et des rimes, des mandoles et des palettes pour traquer nos moments du mal de vivre et de tristesse. En retour, nous leur devons respect et admiration.
Maâchi et le combat de novembre
Quand éclate l’insurrection de novembre 1954, les éléments de l’orchestre Safir Ettarab vont, chacun de son côté, rejoindre le combat armé. Désormais, chacun range son instrument de musique, soit pour rejoindre le maquis et mourir les armes à la main comme ce fut le cas de Mokhtar Okacha (1930-1958) et Larbi Hachemi Oueld El Garde (1934-1959), soit, pour d’autres, intégrer les réseaux urbains FLN.
La clandestinité étant de rigueur, aucun des membres de la troupe ne savait ce que faisait l’autre ou dans quelle cellule il activait. Mostefa Belarbi (1933-1994), le violoniste de la troupe, est arrêté, torturé et jeté en prison en 1957. Zekri Moulay (1939-2005), un jeune percussionniste de la formation musicale, rejoint lui aussi le maquis. C’est le bruit des armes qui remplace les mélodies dégagées par les instruments de musique qui, auparavant, avant l’insurrection, étaient d’autres armes de combat.
Maâchi, qui exerce toujours à Radio-Alger, entretient des visites régulières avec sa famille et sa ville natale où le bruit des bottes se fait entendre tous les jours avec les affronts de la honte et de la terreur. L’auteur de Angham El-Djazaïr, qui a choisi la tenue de son orchestre aux couleurs nationales, s’engage, aux côtés de ses camarades, pour aller à la reconquête de la liberté, triompher ou mourir pour elle.
En 1958, le secteur autonome de Tiaret est dirigé par Hamdani Adda, Oueld Serara, dit Si Othmane. Les incursions de l’ALN au cœur de la cité et les attentats des fidayine sèment le trouble dans les rangs de l’armée et au sein de la population française locale. La réponse à ces défis se traduit par le déclenchement d’une répression contre la population algérienne.
Les quartiers «arabes» sont soumis, de jour comme de nuit, aux contrôles, aux mises à sac qui sont opérés avec hargne et haine. Maâchi prend contact avec le chef du réseau urbain FLN, Hamdani Adda, dont le PC se trouve dans la Région I (Zone VII, Wilaya V). On lui confie plusieurs missions. Il se trouve dans la même cellule que Mohamed Djahlane, un Mozabite de la ville de Tiaret. Ils sont arrêtés en même temps par l’armée française qui avait découvert chez eux des armes et des explosifs. Ils sont écroués en 1958 dans un centre de tri et de transit, situé aux abords des casernements militaires de la Redoute, au sommet de la colline est de la ville de Tiaret.
A quelques jours du 8 juin 1958, un autre fidaï, Djilali Bensotra, est arrêté au lendemain d’un attentat qu’il avait commis. Bensotra figurera parmi les victimes des représailles. Après l’arrestation de Ali Maâchi, un tissal de l’ALN (agent de liaison) se présente chez la belle-sœur El Abadya, l’épouse de Mohamed Maâchi. Il lui demande de lui remettre un paquet de documents que lui avait confié Ali Maâchi quelque temps auparavant. Jusqu’à ce jour (2009), El Abadya ne connaît rien du contenu de ces documents ni revu le tissal qui était au courant des activités de Ali Maâchi. La belle-sœur nous raconte aussi le jour où Ali transporta avec son frère Mohamed un sac de blé chez Mohamed Djahlane. A l’intérieur du sac, il y avait des grenades. Le centre de tri et de transit est une structure de l’armée française où séjournent les soldats de l’ALN et membres des réseaux FLN arrêtés lors d’accrochages où d’investigations. Un séjour qui n’excède pas la durée de trois mois. Après quoi, les résistants algériens, après avoir été soumis aux atrocités de la torture, sont soit traduits devant les tribunaux militaires, soit libérés quand ils ne représentent pas une véritable menace, soit carrément exécutés comme ce fut le cas de Ali Maâchi.
C’est dans l’après-midi du dimanche 8 juin 1958 que Ali Maâchi et ses deux compagnons, Mohamed Djahlane et Djilali Bensotra, sont retirés de leurs cellules, conduits dans un boisement limitrophe de la ville puis assassinés par balle. Les soldats français utilisent l’ignoble et tristement célèbre «corvée de bois», faisant croire que les trois prisonniers avaient tenté de s’évader. Les trois corps sont ensuite transportés jusqu’à la place Carnot de la cité. Le convoi militaire stationne face au commissariat de police. Les trois cadavres sont attachés chacun par les pieds puis traînés et pendus aux branches d’un platane. Comme dans les temps de la crucifixion, les trois corps resteront pendus tout l’après-midi, entourés de soldats français qui avaient tout l’air d’exécuter une danse macabre pour mieux fêter leur forfait. Ils incitaient – parfois sous la menace – les passants tant algériens que français à se rapprocher des platanes pour s’associer au spectacle de la honte. Un spectacle visant à exciter le sentiment de vengeance chez la communauté française de la ville dont certains membres, racistes notoires, venaient carrément cracher sur les corps sans vie. Certains – ils n’étaient pas nombreux – étaient indignés et refusaient que la guerre et la répression conduites contre le peuple algérien utilisent des méthodes aussi barbares. Sur les lieux, un colon de la région de Aïn-Bouchekif, à l’est de Tiaret, Casimir Escourou, anime le sinistre exploit. La guerre éclatée, il devient commandant des Unités territoriales, une milice en uniforme constituée de pieds-noirs décidés à prêter main-forte à l’armée française. Escourou festoie bruyamment le forfait et invite ses pairs à partager avec lui la haine de l’Arabe. L’exposition des cadavres de soldats de l’ALN ou de fidayine est devenue une pratique courante de l’armée française. A Berrouaghia (Médéa), un chef de brigade de gendarmerie assassinait tout «suspect» algérien et jetait le corps dans les principales artères de la ville. A Ammi-Moussa (Relizane), le corps de Ali Guitoun, un chef de commando ALN, fut exposé presque toute une journée dans une place par l’armée française.
A Rahouia (Tiaret), ce sont des cadavres de jeunes Algériens qui, attachés à un véhicule militaire, étaient traînés partout dans la ville. Des méthodes appliquées un peu partout dans le pays pendant toute la durée de la guerre d’Algérie. C’est une ancienne méthode héritée de l’armée française d’invasion. Déjà en 1845, la tête de Mohamed Benallal, l’un des plus valeureux khalifa de l’Emir Abdelkader, fut exposée trois jours durant dans les rues de Miliana, sur ordre du général Bugeaud, alors gouverneur général de l’Algérie. L’horreur, la barbarie, c’était là le comportement choisi pour faire peur et terroriser la population algérienne dans l’espoir qu’elle renonce au combat en se désolidarisant de ses chefs. En effet, le spectacle macabre des pendus de la place Carnot visait à terroriser la population algérienne locale et l’amener à se désolidariser du FLN et de l’ALN. Autrement dit, à renoncer à toute forme de résistance et de combat pour l’indépendance. La répression trop outrageante et trop humiliante crée le sentiment inverse. Les jours qui suivent le deuil, beaucoup de jeunes intègrent les réseaux de fidayine ou rejoignent les unités de l’ALN pour poursuivre le combat. Une atmosphère fort tendue que celle de cet après-midi du dimanche 8 juin 1958. Parmi la population algérienne locale, femmes, hommes et adolescents traversent la place, le cœur trop oppressé par la vue de ces trois corps à qui on venait d’ôter la vie et qui, malgré cette ultime punition, sont livrés à une humiliation extrême. Des jeunes, aussi consternés que les adultes, sans être obligés, préfèrent se rapprocher des corps, peut-être pour mieux identifier les trois victimes des forces militaires françaises. C’est le nom de Ali Maâchi qui circule vite et de bouche à oreille, c’est toute la ville qui apprend l’assassinat de celui qui venait à peine de bercer les âmes de ses plus belles chansons. La communauté mozabite de la cité avait, elle aussi, appris que parmi les trois corps se trouvait celui de Mohamed Djahlane, né en 1934 à Guerara, qui exploitait avec son père un commerce au quartier La Gare. En revanche, personne ne connaissait le jeune fidaï Djilali Bensotra. On saura qu’il était originaire de la région de Oued-Lili, au nord de Tiaret (tribu des Halouia). Même après 1962, nos recherches dans cette région montagneuse furent malheureusement infructueuses. Aucune trace de la famille des Bensotra. Nous avions espéré rencontrer la mère du martyr ou un proche parent dans le but de recueillir davantage d’éléments sur ce jeune Algérien, célibataire, qui n’a opposé aucun marchandage pour se sacrifier pour son pays. Combien étaient-ils dans son cas ? Des centaines, des milliers d’anonymes. Les corps des trois martyrs furent, certes, identifiés, mais personne ne sait à ce jour où se trouvent leurs tombes. Les corps n’ont jamais été rendus à leurs familles endeuillées. Ils sont enterrés secrètement, de nuit probablement, dans une fosse commune ; la fosse commune étant le sort réservé aux Algériens tués dans le combat, assassinés dans les centres de torture ou victimes de la tristement célèbre «corvée de bois» qui consistait à «libérer» des prisonniers et leur tirer dans le dos pour les accuser ensuite d’avoir tenté de s’évader. C’est par une telle méthode que Maâchi et ses deux compagnons furent exécutés. Dans sa livraison du 14 juin 1958, L’Echo de Tiaret rend compte de l’assassinat, le «justifiant» par cette honteuse «corvée de bois». Dans cette version abracadabrante, le journal colonial souligne, sans vergogne : «Au cours de leur interrogatoire, les trois terroristes ont essayé de s’enfuir, ils ont été abattus après les sommations d’usage.» Voilà un mensonge trop grossier et trop absurde qui défie le bon sens et la raison. Comment trois prisonniers pouvaient-ils procéder pour quitter des locaux hermétiquement fermés et barricadés par les barrages de fils barbelés, locaux qui se trouvent dans l’enceinte même d’un important casernement militaire où pullulent des soldats armés jusqu’aux dents ? Le colonialisme, une grande entreprise de banditisme, a toujours vécu par et dans le mensonge, la désinformation et la déformation des faits. Quand un Etat est ouvertement menteur, tous ceux qui le composent ou le servent dans une institution ou dans une autre deviennent eux aussi des menteurs en puissance. Les seules fois où tout ce monde est confondu et parfois même traqué impitoyablement dans l’embarras, c’est dans les salles des tribunaux. Ici, les avocats du FLN dévoilent le système tout entier et, dans des démonstrations magistrales, mettent le mensonge à la merci de la vérité.
En assassinant Maâchi, les Français n’avaient pas éliminé physiquement un homme qui participait au combat armé, ils ont tenté d’assassiner en même temps ce qu’il incarnait, ce qu’il symbolisait comme valeurs culturelles et patriotiques. Il incarnait la patrie qu’il chantait de sa voix et de son luth. Il exprimait à sa manière – la manière de l’artiste— le sentiment patriotique à travers des airs multicolores, séduisants qui continuent aujourd’hui à bercer merveilleusement nos âmes et nos cœurs.
A. B.
(*) Docteur honoris causa, journaliste-historien