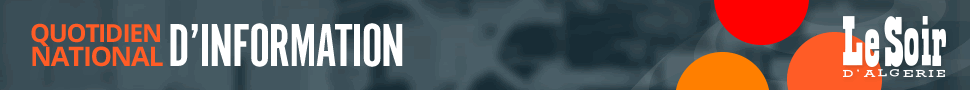Avec ce roman à deux voix, d’une finesse et d’une force émotive remarquables, Nassira Belloula invite à un tumultueux voyage dans les sentiments, la mémoire, le couple, la société, l’écriture. Ou l’histoire d’une femme algérienne qui est revenue de l’autre côté du miroir.
«(...) J’avais le secret des filles épanouies, le secret du cœur, celui de l’amour, car un homme m’a regardée comme on regarde une femme et comme personne d’autre. C’était son regard qui m’embellissait», confiait Maria, l’héroïne de cette histoire. «Inutile de lui demander de qui elle parle. Souvent, elle délire, nourrie par une imagination foisonnante», se disait sa fille Alia. Ce court passage donne un avant-goût des scènes et situations dramatiques où l’auteure alterne rythmiquement les voix et les perspectives, le passé et le présent, démasque le réel en révélant des choses nouvelles, tout en décrivant avec talent les sentiments de ses personnages, leurs fêlures, leurs doutes, les fantômes de leur imagination, leurs joies aussi. Aimer Maria est un roman passionnant, tout en intériorité, corrosif comme une goutte de vitriol. Il sonne vrai comme la grande histoire du quotidien, lorsque la vie est le personnage principal.
Le lecteur est alors convié à l’écoute des mots, à entendre chanter les mots et s’accorder à leur rythme. Nassira Belloula a une belle écriture, précise, poétique, colorée par le rythme, la cadence et la hardiesse des images. C’est une écriture au fort contenu affectif, un tissu réticulaire d’émotions entrecroisées. Pour mieux communiquer cette émotion au lecteur, l’auteure a imaginé, cette fois-ci, la forme d’une histoire en tresse : le roman est construit autour d’un double «je» narratif, avec deux personnages féminins (la mère et la fille) qui ne cessent de s’entrelacer en mêlant passé et présent, sujets, thèmes, caractères, intrigue et révélations, réalité et monde souterrain.
Le titre Aimer Maria fait tout de suite entendre la voix des mots, tant il sonne juste à l’oreille. Juste après, cette citation de Djalâl-ad-Dîn Rûmi en incipit : «Il y a une voix qui n’utilise pas les mots. Ecoute !» Cette musicalité donne vite le la d’un bon livre. Nassira Belloula semble dire au lecteur : «L’histoire de Maria sera une expérience émotionnelle pour toi aussi. Parce que moi, l’auteure, je connais parfaitement la nature de cette émotion qui pousse les personnages à agir comme ils le font.» , A cette émotion motivée, il ne restait plus qu’à donner une forme plaisante, une cohérence, une symétrie, des proportions ; autrement dit, tout ce qui la dramatise et la personnifie. Le roman trouve son originalité par sa conception, affichée clairement à l’entame du chapitre d’ouverture. Début de la pièce vocale à deux voix : «Le jour se lève. Elle ignore les bruits du dehors, toute concentrée sur les battements sourds qui gonflent la robe en coton collée à sa peau. Sa nuit s’est passée dans une succession d’idées noires et au matin, elle se trouve encore dans ce schéma obscur. Son regard bute sur quelque chose de poisseux, elle murmure : ‘’Le père m’a abandonnée et c’est au tour de Dieu de m’abandonner.’’ Je sursaute à sa voix à peine audible, légère et brûlante comme un dard d’insecte qui pique la chair puis gonfle douloureusement comme un bouton. Ses bras s’affairent autour d’elle en tant de tournures de ramures détachées du tronc et qui dansent dans une parade excessive. Elle entasse dans un cabas en toile bleue des vêtements dispersés sur les canapés et sur le tapis du salon où, assise en tailleur, elle trône sur du ravage. Je me penche, lui touche l’épaule. Elle pirouette sur elle-même pour me tourner le dos et murmure entre ses dents serrées : ‘‘Je retourne chez moi’’.» Ce passage prouve une grande maîtrise de la tension dramatique, dès les premières phrases.
De fait, on est aussitôt happé par cette histoire, avec un tel mode de narration kaléidoscopique et mouvementé. Les voix en alternance, comme une nouba de femmes, se croisent, se questionnent, se répondent, se font écho dans la distance, se livrent, se délivrent par bribes, révèlent des fragments de vie. Un roman choral décliné sur le ton du conteur. Un roman moderne qui invite aussi à une poétique méditation sur l’exil intérieur, la condition humaine, l’infini servage de la femme, les droits et le rôle de la femme dans la société, le désir de se réaliser pleinement et librement. En cela, le récit se mue en une ode à la liberté, aux combats nécessaires pour acquérir les droits que toute femme se doit d’obtenir. Ces destinées de femmes sont souvent peuplées de luttes sans merci entre désirs et contraintes. «Je suis la survivante d’un naufrage mais bientôt ne me restera que la trace de cet instant où j’aurai triomphé de moi-même. Fuite. Fugue. Faiblesse. Fêlure. Folie. Voilà ce qui me vient à l’esprit», résume Maria. Dans cette expression ramassée, la lettre F de la femme-étoile à cinq branches donne une clé de lecture. Pentacle d’une tragédie (en cinq actes) qui va se jouer tout au long des dix chapitres du roman. Aimer Maria raconte l’histoire d’une femme qui, malgré elle, a été jetée dans la gueule du loup. Maria a été mariée à 16 ans à un inconnu, il y a près de trente ans de cela. Son père avait «jeté sa fille au pied du premier venu sans s’assurer qu’il allait l’aimer et la chérir». Il l’avait donnée en mariage pour réparer une dette familiale, alors qu’elle vivait une idylle naïve et tendre avec son cousin Ali. C’était un mariage forcé, tombé au mauvais moment et avec le mauvais partenaire. Celui qu’on lui avait destiné (lui, tout comme le père de Maria ne seront jamais nommés dans le roman ; des personnages qui sont surtout des personnifications, comme dans une parabole) ne l’aimait pas non plus, n’appréciant ni son caractère ni son physique. Il va alors faire en sorte de la briser moralement, en l’avilissant d’une manière insidieuse et perfide. Maria «sait qu’elle n’a été qu’un objet déplacé par la volonté de son père d’une maison à une autre. Mais dans la maison du mari, il n’y a rien pour elle, elle n’a pas de place, aucun lien ne la rattache à ce lieu. Elle n’est ni la fille chérie ni la femme adulée. Ici, elle est la bru. Une procréatrice et travailleuse domestique. Son rang est le dernier dans l’échelle sociale. Son unique ambition devient le bien-être du mari et la religion lui dicte de se prosterner à ses pieds».
Dans la maison du mari, «le corps tombe en disgrâce. (...) Il règne désormais sur elle par la honte et la terreur. Il réussit à tout lui arracher ne lui laissant que ce regard vide qui se dérobe, qui court au ras du sol comme un insecte pris au piège cherchant un trou». Maintenant que Alia «pénètre ses frontières confuses», elle se rend enfin compte que sa mère a été vampirisée : «Finalement, chacun de nous a grignoté un bout d’elle : la belle-mère, le père, puis nous, ses quatre filles, ses deux fils et le bébé, mort-né. (...) Accepter d’être réduite à cela, à juste être une procréatrice, à tuer toute autre forme d’émotion chez elle. Comment ne pas voir une sorte d’aliénation dans cette destruction physique et même psychique ?» Petit à petit, Maria devient l’ombre d’elle-même. Une ombre séquestrée et que «l’autre» n’a pas besoin d’écraser physiquement, ayant opté pour la torture morale : «M’humilier et me rabaisser suffisaient.» Dans «la maison-tombeau refermée sur elle», Maria perd fraîcheur et vitalité, «elle sent vers l’âge de vingt ans son corps sonner creux comme une coquille vide». Plus encore, «son corps — tourment et noirceur — elle apprend à le détester, le haïr, le priver de nourriture, le marquer d’éraflures douloureuses». Pour survivre au néant et aux morsures des pulsions morbides, elle se réfugie dans son monde à elle. Un monde parallèle où elle se laisse aller à l’exaltation, à la purification, à une certaine sublimation. «Chez lui, dit-elle, j’ai appris à survivre dans mon propre mutisme et dans sa loi à lui. Année après année, je m’oublie en créant un monde imaginaire dans lequel j’évolue, dans lequel je flétris et meurs.» Ainsi, chaque fin d’après-midi, dans un coin du jardin de la maison, sous le citronnier qui lui avait été offert par Ali, «elle se laisse aller à ses errances mentales. C’est ici qu’elle défait et refait le monde à sa convenance». Le rituel est quotidien et précis. Et puis vient le jour où s’opère comme un déclic dans l’esprit de Maria. Ce jour-là, «c’est sa conscience qui émerge d’un long sommeil» lorsqu’elle entend l’imam affirmer, dans une émission religieuse à la télévision, que «l’épouse, pieuse, dévouée et croyante sera récompensée par Allah, qu’elle entrera au paradis et y retrouvera son mari pour l’éternité».
Le sermon déclenche une tempête sous un crâne. Certes, l’imam a jeté Maria dans la tourmente, mais il l’a surtout affranchie : «Il vient de me rendre ma liberté en me mettant dans une barque sans aucune rame, mais je me sens capable d’arriver sur une rive, les bras chargés de mes péchés.» Maria ne veut pas se résigner à appartenir au mari dans une autre vie, elle veut partir, rentrez chez sa mère Rosa. Elle n’a plus peur et, «aujourd’hui, la seule façon pour elle de retrouver sa sérénité et de récupérer sa propre estime est de partir, quitter notre père» (Alia). Pour enfin rejoindre Ali au paradis, elle devrait d’abord divorcer...
Bien sûr, ses filles tombaient des nues : «Nous n’avons aucunement partagé les choses de sa vie intime, et chercher maintenant un chemin vers elle nous met mal à l’aise. La chose semble même impossible, l’accès vers son esprit étant verrouillé.» Alia (prénommée ainsi en hommage à Ali, disparu trop jeune) va alors tenter de comprendre, d’entrer dans le monde de Maria «à tâtons, à petit pas». Une mère qui «a fait de sa vie un décor en trompe-l’œil» et qui «a appris à se défendre par la soumission s’évitant ainsi le moindre reproche, la moindre remontrance et la moindre pitié». Dans ce roman à deux voix, la fille raconte ce qu’elle découvre pendant que la mère confie, par fragments, tout ce qu’elle a vécu.
C’est un va-et-vient incessant qui, par petites touches, dévoile les fêlures que rien ne ressoude, les bribes d’une vie placée sous le signe de la perte, de la peur et du renoncement. Nassira Belloula opère ici un subtil travail de dévoilement sur une société bridée par les interdits, les non-dits, les silences, les contraintes, le conformisme et l’hypocrisie. Dans une telle société, la femme devient «mère et épouse. Deux rôles qui l’excluent de toute autre alternative. Elle ne peut plus être femme. (...) En fait, c’est tout le regard de la société qui la décompose, la remodèle, qui trace son parcours : de femme à épouse, d’épouse à mère. Il n’y a pas de retour possible vers la femme.» De là à avoir des rêves, une libido... «Dans notre monde, le sexe ne s’envisage que dans la tête et ne se livre pas.» Les hommes, eux, ont toujours usé de la violence physique ou symbolique, jouant aux cerbères et aux marionnettistes : «Ils prétendent tout savoir, tout contrôler, jusqu’à nos désirs et nos rêves comme si Dieu avait été défaillant dans notre création.» Alia se dit «que le fait d’être diplômées et financièrement indépendantes fera la différence. Les temps ont évolué». Mais rien n’est moins sûr, il suffit d’un mari pour «faire de nous des passantes invisibles». Dans une société de défiance et d’asservissement, dominée par le moralisme religieux, le manque de confiance, les évitements et la fragilité des sujets, il est très difficile de se révolter contre l’injustice immanente. «Les non-dits de notre mère, par honte, pudeur ou discrétion, ses secrets, ont fait qu’on ne sait rien, jusqu’à ce que l’histoire de sa vie me soit révélée et me bouleverse. (...) Obéir à Dieu et subir un homme dans sa chair et son amour propre, juste pour gagner le paradis. Pas pour toutes les récompenses promises, mais juste pour être avec Ali. Ainsi, elle est allée d’un renoncement à un autre jusqu’à s’anéantir juste dans le but de retrouver Ali», avait décrypté Alia.
Pour sa mère, la religion était un remède à ses souffrances psychiques. Mais, depuis le sermon de l’imam, «elle s’abandonne à une incommensurable rage. (...) Il est dur de voir sa foi ébranlée. Pour notre mère, la religion régit tout dans la vie. Faute de bonheur, elle puise chez les fanatiques des apaisements ; ils savent si bien agiter devant les âmes peinées les mots miracles : patience, récompense, repentance.
à présent, elle regarde son reflet dans toutes surfaces. Le miroir ne lui fait plus peur. Elle y cherche son visage dépouillé de tous les masques qu’elle s’était évertuée à porter.» Nassira Belloula continue de trouver les mots qui disent les femmes et qui font douter les certitudes creuses. Des mots qui saisissent la femme dans son être vrai, dans sa subjectivité, dans tout ce qui est caché profondément et qui, démystifié et mis au jour, révèle les malaises et les traumatismes dont souffre la société.
Parfois même, les mots — bruts — témoignent de beaucoup de courage et de lucidité chez l’auteure. «Depuis la nuit des temps, le système patriarcal a trouvé écho dans la religion et fait de Dieu un allié dans cette aliénation acharnée contre tout ce qui est féminin. Ainsi se perpétue ce système qui tire sa puissance de sa verge et non pas de son cerveau, opprimant et réduisant à néant chaque voix de femme qui voudrait sortir du chaos. L’évolution de l’espèce, une belle fable, quand on voit le comportement du père et des hommes de chez nous», commente Alia.
Une fable... Ali, une figure allégorique : «Ce soir, j’écoute notre mère avec un sentiment de culpabilité et je vois son regard s’animer comme si sa seule et possible régénération était Ali. Chaque instant avec lui est une étape d’un voyage fabuleux. Et elle nous permet d’entrer dans cet éclat de chaleur, à cet instant où se pose sur ses paupières le souffle de l’absent et que ses yeux fleurissent comme de délicats jasmins. Il fallait être Ali. Il fallait juste aimer Maria.» Dans cette parabole, la mort serait-elle alors la seule réalité ? «Comme dormir toute enclose dans les bras d’un mort ?» Pour Maria, en tout cas, «et sur son chemin, il y a à un bout la silhouette du père et à l’autre celle d’Ali. Quelle que soit la direction prise, elle se retrouve face à un mirage.» Illusion et chimère.
Aimer Maria est un roman dur et en même temps chargé d’une infinie tendresse, intimiste et psychologiquement profond, très actuel dans son intemporalité. Le contraste de lumière et d’ombre, les symboles chargés de sens (la mer qui représente l’inconscient et est source de toute vie ; l’anneau de mariage dont se défait Maria pour se libérer ; le citronnier pour se purifier et s’épanouir...), les procédés stylistiques de la métaphore et de la prosopopée, la composition polyphonique et les effets de miroir, de spécularité et d’enchâssement transportent le lecteur dans une autre dimension, mais déliée et aérienne. Pour aider le lecteur à aimer toutes les Maria qui veulent être libres, ou à tout le moins n’être enchaînées que par l’amour.
Hocine Tamou
....................
Nassira Belloula, Aimer Maria, Chihab éditions, Alger 2018, 158 pages, 750 DA