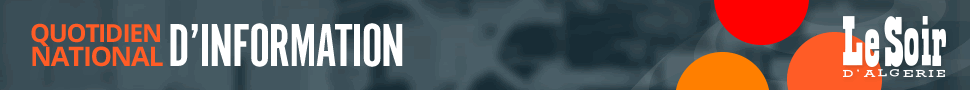En plus d’être une vraie fresque et une saga familiale, Le réveil d’une mère exprime en profondeur la condition de la femme algérienne depuis près d’un siècle. Histoire d’une vie, le roman est en même temps une double analyse : sociologique, et psychologique surtout.
L’analyse sociologique s’accompagne, en effet, d’une dissection des états de conscience des personnages, de leurs sentiments, de leurs comportements, de leurs motivations. La psychologie de l’inconscient (voire la psychanalyse) permet ainsi de pénétrer les profondeurs intimes, secrètes de l’être, de révéler les non-dits et ce qui se cache derrière les ombres. Meriem Belkelthoum a naturellement privilégié le point de vue humain (c’est une mère qui s’exprime ici, librement, en usant du «je» personnel qui humanise encore mieux le récit) pour présenter le sujet de la condition féminine en Algérie, un sujet aussi complexe que sensible. Il fallait aussi à l’auteure déconstruire quelque peu les codes du genre romanesque pour obtenir une meilleure radioscopie des structures sociales et psychiques qui déterminent et perpétuent la discrimination, la ségrégation des sexes, les rapports de pouvoir, les atavismes, les violences multiformes, la régénérescence d’un système patriarcal rétrograde. Toute l’histoire de Fatma, la narratrice, est alors racontée avec l’esprit, l’intelligence lucide et la sensibilité qui permettent de percevoir, de comprendre, d’exprimer les choses avec clarté, perspicacité. Le déclic salutaire s’est opéré après s’être réveillée d’une apathie pénible : la mère finit par ouvrir grands les yeux sur elle-même et sur le monde, et voir l’autre côté du miroir.
Pour le lecteur, le texte en quatrième de couverture est déjà plein de promesses : «Née dans l’Algérie profonde pendant la colonisation, Fatma, l’héroïne de ce livre, était vouée à une vie sans relief, si ce n’est qu’elle parlait la langue de l’occupant à la perfection.
Un matin, un miracle se produit : elle s’aperçoit qu’elle peut lire et écrire. Le choc de l’écriture lui fait découvrir la capacité de se regarder sans fard, de penser et repenser sa vie pour en connaître le sens. Elle nous raconte comment elle se libéra des mystifications sociales qui l’emprisonnaient dans sa propre maison, de l’emprise de son mari et de ses enfants.
La transformation de l’héroïne, de femme illettrée à écrivaine savante, donne à ce récit une dimension unique qui nous permet d’entrevoir les espoirs, passions, rêves et aspirations jusqu’ici enfouis dans le silence qui enveloppait celles privées de la parole écrite.
En se dédoublant, Fatma l’écrivaine jette un regard tour à tour réprobateur et compatissant sur Fatma l’analphabète et nous fait ainsi découvrir la vie intérieure d’une femme au sein de laquelle rébellion et résignation se disputent la scène. Mue par un désir de liberté indomptable, elle se bat contre les iniquités de la vie quotidienne à sa manière. Pleine de cran, le verbe haut, bi-lingue, elle tient tête à tous ceux qui portent atteinte à sa dignité. à travers ce récit, se profile la fresque de l’Histoire, avec ses personnages politiques, ses guerres, ses familles en tumulte, ses lois, ses coutumes battues en brèche, ses saints protecteurs, ses défaites et ses succès. Fatma nous entraîne dans une course effrénée au bout de laquelle nous découvrons qui nous sommes. Quelle aventure !»
Le récit s’ouvre sur un prologue, le prélude qui relate le «miracle» de la découverte de l’écriture et qui précède l’histoire émouvante de Fatma. L’écriture qui va changer sa vie. Car «la parole si vivante qu’elle fût se dissipait dans l’air. L’écriture par contre reste, demeure, survit». Alors, dans son appartement à Alger, où elle vit seule depuis plusieurs années parmi ses chats, ses canaris et sa tortue, Fatma se mit à écrire : «(...) comme pour répondre à une voix qui me dit : ‘‘écris !’’
J’écris : ‘‘Moi, Fatma, fille de Sidi, j’écris. Je voudrais conter mon histoire.’’.» Elle avait pris le cahier aux bords jaunis de sa fille Meriem qui lui avait dispensé «des séances d’alphabétisation»... L’écriture comme recherche de soi, pour épouser au plus près ce qui se passe à l’intérieur de la narratrice, pour dire l’indicible. L’écriture comme espace de liberté et pour dire la révolte : «à mesure que je trace des lettres sur le papier, je peux voir plus clairement les contours de mon existence et des choses en général. Je ne trébuche pas sur mes souvenirs ; ils ne bloquent plus mon horizon ; ils ne forment plus le contexte dans lequel je plaçais toutes choses. C’est là un sentiment de prise en charge qui ne semble plus se limiter à mon feu époux ou à mes enfants. Je vois d’en haut ce que j’ai vécu en bas. Oui, pour moi, c’est cela la liberté. Meriem m’a souvent demandé pourquoi je lançais cette affirmation : ‘‘Moi, je suis une femme libre (ana houra) !’’ chaque fois que j’avais une altercation avec Mimi, ma fille aînée, ou avec ma voisine. (...) Je voulais dire que je n’étais pas inféodée, que personne ne dirigeait ma pensée, et surtout que je ne m’embarrassais pas des conventions qui m’auraient intimé le silence. Moi, je dis ce que je veux, quand je veux, sans peur des conséquences. Mais maintenant, je m’aperçois que je n’étais pas libre ; j’étais rebelle. Maintenant, je sais ce qu’est la liberté. C’est cette force qui me fait asseoir à la table de la salle à manger pour écrire, et écrire pour comprendre et expliquer la liberté que je croyais être mienne comme si la clamer sans cesse me la faisait posséder.» Etre fort dans l’adversité, l’épreuve. Ou encore, comme le rappelle la maxime de Nietzsche : «Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort» ! Fatma est une incarnation vivante de ces aphorismes. L’écriture puissante et somptueuse de la narratrice tisse les fils de la chronologie, de la géographie, de la généalogie, de l’histoire, aussi de l’individu en tant qu’être particulier. Mais une toile qui offre de la perspective et de la distance pour mieux comprendre l’Histoire. Grâce au résumé, à la digression, à l’analyse et au connexions qui permettent de passer du particulier au général. «Je suis née dans la ferme de mon père, juchée sur une colline, chez les Ouled M’alla, l’année où la France a essayé de faire pousser du riz dans la vallée du Chélif, autour de Jdiouia où ma grand-mère et ma tante maternelles habitaient. Je suis noble car mon père aussi bien que ma mère sont originaires de Seguia El Hamra (...).» Fatma était «née intelligente», contrairement à sa mère : «Oui, je le répète ma mère était bête. Elle habitait tout près d’une école française mais n’a pas eu le bon sens de m’y faire inscrire. L’idée ne lui avait même pas traversé l’esprit ! Il est vrai que divorcée, flanquée de deux filles, et soucieuse de gagner sa vie, elle passait son temps à remplir des commandes de tissage.» Fatma fut élevée par sa grand-mère Aïcha, à Jdiouia. L’enfant avait sept ans à la mort de l’aïeule.
Sa tante Kheira la ramena chez sa mère, à Relizane. C’est là qu’elle apprit à parler le français au contact de Fifi et Adrienne, deux filles d’un colon. Dans sa longue et pertinente digression sur les «alphabètes» et les «analphabètes», la narratrice écrit notamment : «Je manie la langue des alphabètes comme mon aïeul maniait l’épée. C’est un objet parmi tant d’autres. Je ne lui ai jamais permis de se disputer mon âme ; elle ne le put car je l’ai capturée dans la rue pour ainsi dire. (...) Je la possède ; elle ne me possède pas.» Passionnant travail de réflexion et d’introspection sur «les choses linguistiques», sur la «tragédie ontologique» qui fait que «ce sont des hommes et des femmes empêtrés dans leurs sens de l’histoire, si vulnérables devant l’autre, qui exercent leur pourvoir et leur supériorité d’»alphabètes» sur les mères «alphabètes»). (Le préfixe ana et qui donne «analphabètes»).
En l’occurrence, Le réveil d’une mère est aussi un roman à thèse (ici politique, philosophique, morale, idéologique...), puisque le récit analyse, en parallèle, «la crise ontologique des juges, femmes et hommes» de l’Algérie pré et post-indépendance. «Leur volonté de puissance sur les mères comme moi, alphabètes préfixées, compense leur vulnérabilité devant l’autre. Ils ont choisi de vivre dans les interstices des lettres de l’alphabétisme d’emprunt. Tant mieux pour eux. Mais pourquoi n’assument-ils pas leur choix et ne vivent-ils pas heureux ? Pourquoi veulent-ils nous écraser ? Pourquoi ont-ils fait de notre aliénation la condition de leur accession à l’autre ? Est-il possible que nous, les mères, soyons la cause de cette tragédie ontologique ?
Avons-nous failli en tant que mères ? Il m’incombe s’examiner ma vie de mère pour trouver des éléments de réponse à cette question», conclut la narratrice.
Au printemps de l’année 1929, Fatma fut mariée à Adel, un des notables de la ville de Relizane, alors qu’elle n’était pas encore nubile. Déjà divorcé d’avec cinq femmes, «le vieux et strict» Adel «forma le projet de se créer une femme selon ses propres spécifications». En clair, «j’étais l’objet de son expérience : il me prit encore enfant, m’isola du reste du monde, m’enseigna cuisine, pâtisserie, ménage et prière. J’étais sa création et sa chose.» Le premier enfant, Nadir, naît après trois ans de mariage. Trois ans plus tard, naissance de Mimi.
La deuxième fille, Safya, née elle aussi à trois ans d’intervalle, en 1938, s’éteignit à l’âge de six mois. «La mort de Safya fut le prélude à une série de catastrophes» : les affaires de Adel commencèrent à péricliter, il vendit ses biens et «trouva son salut dans l’exil à Mosta». Un exil dans un logement exigu, une sorte de cachot. «C’est alors que je commençai à voyager, seule, par train ou par car, pour rendre visite à mon père aux Ouled M’alla (...). Notre émigration (...) marqua mon passage à la liberté. Ce fut comme un passage à l’âge adulte. Je me trouvais une énergie nouvelle, une confiance en moi inouïe. J’avais laissé l’adolescente déprimée et muette à Relizane. Maintenant j’étais femme pensante et agissante (...) Adel ne disait mot : sa chute sociale et matérielle signifia mon affranchissement.» Naissance de Meriem pendant la Deuxième Guerre mondiale... Les enfants grandissent.
Fugue de Nadir à Tunis, suivie de la fugue de Mimi à Alger. Ségrégation sociale et ségrégation dans l’éducation sous le régime colonial. Faits et états psychologiques des personnages. La structuration spatiotemporelle du récit narratif gagne en cohérence, en cohésion et en clarté à mesure que l’auteure décrit, explique et analyse les faits du comportement social (ici de chacun des membres de la famille de la narratrice, à commencer par le propre comportement de celle-ci). Ainsi en est-il, par exemple, des rapports «fils et mère» (titre de chapitre) à travers Nadir, le fils aîné et son unique garçon.
Mais pourquoi donc Nadir n’est-il pas un homme «normal», épanoui ? Pourquoi ces écarts et ces comportements incompréhensibles ? «Maintenant que je peux écrire, je réfléchis à la signification de cette logique qui enchaîne tant de mères à des fils indifférents ou abusifs (...) La triple souffrance que Nadir infligea à son père (par sa fugue, son refus de retourner au cours complémentaire, sa ruine du magasin) n’était sans doute que sa manière d’exprimer sa colère contre un système politique et social donc il avait hérité.»
Les facultés cognitives de la narratrice aiguisent le raisonnement, le jugement, la mémoire, l’imagination. «L’écriture devrait me permettre de me libérer, de me soulager de mes souffrances inexplicables», pense-t-elle. Mais, «est-il possible que la libération par l’écriture soit avant tout libération de nos névroses, de tout ce qui berce nos certitudes, nos illusions ?» Pendant ce temps, la saga familiale se poursuit en contrepoint de la fresque historique algérienne.
Guerre d’indépendance, mort d’Adel («l’histoire qu’il incarnait n’était plus»), libération... Quelques années plus tard, à Alger où elle s’était installée après l’indépendance, Fatma se sent «sans passé, rajeunie, revigorée». Elle a toujours cette impression d’être «plus moderne» que ses enfants (elle explique pourquoi). Surtout, elle fait la découverte de son corps : «Je me souviens du jour où mon corps se révéla à moi.»
La trame de la psychologie de l’intelligence continue à se nouer et se dénouer tout au long des chapitres suivants, lorsque la narratrice explique, par la phénoménologie notamment, comment se tissent les rapports mère-enfants et comment «mère, fille et femme» sont formatées et conditionnées. Et cela à contre-courant des dissertations des «psychologues coloniaux et leurs émules», bien sûr, mais aussi des discours des féministes occidentales. Le deuxième exil de Fatma aura lieu au cours de la décennie noire.
A la fin de son récit, la narratrice s’adresse à toutes les mères. Elle leur dit, entre autres, ceci : «Mes sœurs, nous ferons l’Histoire, notre Histoire, celle que nos enfants et leurs enfants ont réprimée, rendue orpheline.» Et, pour faire l’Histoire, les femmes ont l’amour pour principale arme, mais aussi la confiance en soi et la connaissance.
Hocine Tamou
Meriem Belkelthoum, Le réveil de la mère, Aframed éditions, Alger 2019, 206 pages.