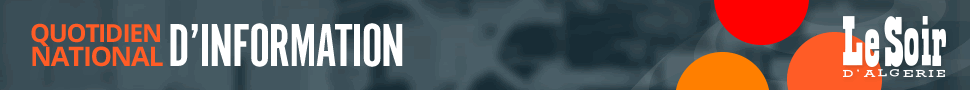Propos recueillis par Mohamed-Chérif Lachichi
En cette période de confinement dû à la pandémie de la Covid-19, la réalisation de cet entretien exclusif avec le fidaï Mohamed Bensadok, âgé aujourd’hui de 90 ans et qui vit à Blida, sa ville adoptive, n’a été rendu possible qu’à distance. Avant d’aborder son fait d’armes, une opération d’éclat qui a largement influencé l'opinion publique, les intellectuels et les milieux politiques français en 1957, il a tenu à perpétuer, à travers son récit, la mémoire d’une phase importante de la Révolution, celle de la guerre d’Algérie en France.
Le Soir d’Algérie : Quel a été votre premier engagement politique ?
Mohamed Bensadok : C’est d’abord par le scoutisme, une école de militantisme et terreau de nobles valeurs, que je me suis rendu compte de cette abomination qu’est le colonialisme. J’étais «louveteau» à la section «El Mouna» des Scouts musulmans algériens (SMA) de Annaba. En 1947, à l’âge de 16 ans, je devais prendre part au jamboree mondial qui s’était déroulé à Soissons, en France. Nous étions 5 à avoir été sélectionnés. Un regroupement préalable de la délégation des SMA avait eu lieu à Sidi-Fredj, un endroit emblématique s’il en est. Là, j’ai été profondément marqué par le discours de Si Mohamed-Larbi Demagh-El-Atrous qui nous avait expliqué les thèmes de l’étendard algérien. J’en avais été secoué. Je venais de découvrir le sens du mot «nationalisme» et ma patrie, l’Algérie, pour laquelle j’étais prêt à donner ma vie. Sur le bateau, nous avions organisé tout un cérémonial pour jeter à la mer les drapeaux français avec lesquels nous devions défiler. Il faut ajouter qu’à cette époque, un évènement mondial venait de se produire. C’était l’indépendance de l’Inde et du Pakistan qui a contribué à me forger également une conscience politique.
Comment en êtes-vous venu au maniement des armes ?
En 1951, j’ai effectué, dans le cadre de la conscription obligatoire, mon service militaire qui m’a permis de me familiariser avec l’armement. J’y ai acquis notamment une expérience dans l’usage des mortiers que j’avais déjà la ferme intention d’utiliser contre la France coloniale.
Comment vous êtes-vous retrouvé en France métropolitaine ?
Muni d’un CAP d’électricien-plombier, j’ai voulu d’abord poursuivre une formation professionnelle pour obtenir un diplôme d’ingéniorat. Arrivé à Strasbourg, le 3 mars 1955, j’ai trouvé le FLN qui m’attendait de pied ferme. Là, on m’a dit que la Révolution avait besoin de gens cultivés et expérimentés dans le mouvement associatif ainsi que dans le maniement des armes. Ma première mission a consisté à commenter des articles de presse, une tâche fastidieuse que je trouvais peu exaltante, moi qui voulais en découdre avec les forces coloniales. Grâce à mon instruction militaire et sur recommandation du défunt Abdelkrim Souici, un enfant de Annaba, membre du comité fédéral, j’ai pu rejoindre en 1956 le premier noyau de l’action armée, à savoir la «Spéciale» (une organisation militaire calquée sur l’Organisation spéciale (OS) que le PPA-MTLD avait créée en 1947, ndlr). Je fus installé à Paris au 17, rue Saint-Jacques, dans le quartier de Saint- Michel. Très vite, je me suis retrouvé à la tête du premier groupe armé. Le premier chef venait d’être tué par les Messalistes du MNA (Mouvement national algérien, ndlr).
Pouvez-vous restituer, pour nos lecteurs, le contexte de l’époque?
C’était une période de flottement qui laissait à penser que la révolution algérienne battait de l’aile. Il fallait un nouveau souffle. En décidant de porter la guerre en France, le FLN voulait surtout marquer les esprits. C'était la première fois dans l'histoire des luttes indépendantistes qu'un mouvement procède, ainsi, à des attaques sur le sol même du colonisateur. Il s’agissait de mobiliser également la communauté algérienne et inciter, par la même occasion, la France à garder ses soldats sur le sol métropolitain pour alléger la lourde charge qui incombait aux combattants dans le maquis en Algérie. Le déclenchement de l’action armée et l’ouverture du 2e front en France devaient constituer un tournant dans la guerre. Nous devions provoquer un choc psychologique et, pour tout dire, semer la terreur en France même !
Dans quelles conditions aviez-vous été désigné pour cette opération dite «Parachutiste», une première du genre sur le territoire français ?
Je dois dire que cette mission n’était pas la mienne au départ. J’ai dû pallier une défection, à la dernière minute. Mon chef, Mohamed Aïssaoui, m’a remis l’arme, un revolver automatique de calibre 7,65, deux numéros d’immatriculation de véhicules et un ticket d’entrée au stade. J’ai reçu l’ordre formel d’abattre à la fin du match Ali Chekkal et de déclarer, en cas d’arrestation, que j’étais envoyé par le FLN pour abattre le «dernier ami musulman des Français».
Et pourquoi ne pas avoir tué tout simplement le président français René Coty, présent sur les lieux ?
Mes chefs ne me l’ont pas ordonné. Je devais m’en tenir aux directives données. Il fallait exécuter seulement le traître Ali Chekkal et personne d’autre !
Racontez-nous ce qui s’est exactement passé ce dimanche 26 mai 1957, aux alentours de 17h, au stade olympique de Colombes...
En entrant au stade, j’ai tenté de rejoindre d’emblée la tribune officielle où se trouvait la loge présidentielle dans laquelle se pavanait Ali Chekkal aux côtés du chef de l’État français. Mais on m’a refusé l’accès. J’ai dû alors regarder le match à partir des gradins fulminant contre mes responsables qui n’ont pas jugé utile de me remettre un billet pour la tribune s’agissant d’une mission si importante. Néanmoins, le match était fort plaisant et ce, d’autant que sur le terrain évoluaient plusieurs joueurs algériens dont mon ami, le défunt Saïd Brahimi dit le «Coq», un natif de Annaba et futur membre de l’équipe du FLN. C’est lui qui inscrira le but de la victoire pour le compte du FC Toulouse que je n’avais pas vu puisque j’étais sorti du stade six ou sept minutes avant le sifflet final. A ce moment-là, je me suis rendu compte que les portes de sortie étaient toutes fermées. Tous les accès étaient bouclés. Un dispositif de sécurité très courant destiné à permettre aux officiels de quitter les lieux avant le public. J’ai eu beau chercher, par ailleurs, sur le parking les véhicules indiqués par leur immatriculation, sans résultat. Aussi, vu les circonstances, j’ai cru comprendre que l’opération était annulée puisqu’il m’était quasiment impossible d’approcher le cortège du président René Coty qui a vite fait de rejoindre le palais de l’Élysée. C’est alors que j’ai aperçu le salopard en compagnie du directeur général de la police et du préfet de police de Paris avec qui il conversait tranquillement. Signe du destin ou coup du sort, le traître s’est présenté à moi, comme par miracle. Petit, trapu, avec une chéchia sur la tête et portant des lunettes sur le nez, il avait, décidément, ce jour-là, un rendez-vous avec la mort. Il est venu seul vers moi. Il était à deux mètres à peine. Difficile de le rater. Mohamed Aïssaoui qui était le responsable chargé de superviser l’opération était posté à proximité et ce, à mon insu. C’est alors qu’il m’a confirmé d’un hochement de tête l’identité de la cible en m’intimant l’ordre de passer à l’action. Sans réfléchir, j’ai tiré aussitôt à travers la poche. Je n’ai même pas eu à sortir l’arme. J’ai tiré à travers l’étoffe même du vêtement pour l’atteindre en pleine poitrine. Je n’ai tiré qu’une seule balle. Je n’aurais, d’ailleurs, jamais pu en tirer une autre puisque la culasse du revolver s’était coincée dans ma poche.
Vous serez appréhendé sur-le-champ…
Oui, j’ai vite été repéré. Des policiers se sont jetés sur moi à plusieurs et sont parvenus à m’immobiliser. Ils voulaient me lyncher n’était l’ordre du préfet de police de me garder vivant. J’ai reçu tout de même quelques coups bien sentis…
S’ensuivra un interrogatoire plutôt musclé…
Non, pas vraiment. J’ai été emmené au Quai des Orfèvres, siège de la préfecture de police de Paris, où j’ai subi un interrogatoire qui a duré, il est vrai, toute la nuit, de 17h jusqu’à 5h du matin. Dans mes réponses aux enquêteurs, j’ai dû improviser et changer la version qui m’avait été ordonnée d’adopter, à savoir déclarer mon appartenance au FLN. Et pour cause. Dans le train qui m’emmenait au stade de Colombes, j’avais déchiré tous mes documents et photos que contenait mon portefeuille. Mais j’avais oublié un papier qui s’est avéré très compromettant. Il s’agissait du croquis de la raffinerie de Rouen en préparation à une action de sabotage de la «Spéciale». J’ai donc tout fait pour détourner l’attention des enquêteurs. J’ai préféré changer de tactique et déclarer avoir agi seul en tuant le «dernier ami musulman des Français» plutôt que de dévoiler, sous la torture, une opération à venir ou encore de divulguer les noms de mes camarades. Je me suis fait donc passer pour un «volontaire de la mort», un simple étudiant, idéaliste et épris de justice.
Ce qu’on appellerait aujourd’hui un «loup solitaire»…
Oui, tout à fait. J’ai continué à nier tout lien organique avec le FLN jusqu’à créer, de toutes pièces, un complice fictif, un certain « Slimane » qui n’existait que dans mon esprit. Ce personnage auquel j’ai fait tout endosser est venu en quelque sorte à ma rescousse afin de brouiller les pistes avec une foule de détails à l’appui. Comble de l’ironie, «Slimane» sera activement recherché par toutes les forces coloniales. En vain !
Avez-vous été torturé ?
Non, les policiers n’ont jamais éprouvé le besoin de le faire puisque j’ai répondu, pour ainsi dire, à toutes leurs questions en livrant même à chaque fois un nouvel indice. Je dois d’ailleurs ajouter qu’à aucun moment de ma détention, je n’ai eu à subir de violences ni de brimades. Au contraire, j’ai toujours été traité avec respect. Dieu m’a donné, ainsi, du courage, de la sagesse et surtout beaucoup d’imagination pour affronter la situation. Cela dit, mon stratagème et mes faux aveux n’ont pas empêché un juge d'instruction, M. Perez, de se déplacer le lendemain pour m’inculper d’homicide volontaire et d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État…
Quelle a été la réaction «politique» des autorités coloniales ?
Devant le fort retentissement international ainsi que l’impact suscité auprès de la population et notamment de la communauté algérienne émigrée en France, les autorités ont préféré minimiser le fait. La thèse de l’acte isolé a vite été privilégiée pour éviter, semble-t-il, une politisation outre mesure de l’affaire qui avait fait, faut-il le rappeler, grand bruit. Cela arrangeait, au fond, tout le monde. Pour notre part, nous étions très sereins car notre but était atteint. L’essentiel est que le déclic que nous projetions a bien eu lieu.
Les choses n’en resteront pas là. Votre procès du 9 au 11 décembre 1957 eut un grand retentissement. Il constituera un nouveau rebondissement de l’affaire et restera même dans les annales judiciaires. Parlez-nous-en...
Mon avocat, maître Pierre Stibbe, auquel je ne cesserai de rendre hommage, avait eu la lumineuse idée de citer à la barre pour ma défense des témoins prestigieux à l’image de Germaine Tillon, Jean-Paul Sartre, Louis Massignon, Simone de Beauvoir, ou encore André Mandouze. Il y avait également l’ancien maire d’Alger, Paul Tubert, un ancien général de gendarmerie, ancien résistant et auteur du premier rapport d’enquête sur les massacres du 8 Mai 1945. Le choix de ces témoins s’est avéré très judicieux. Leur intervention à ma décharge et dont j’en tire une certaine fierté a consisté en un réquisitoire implacable contre le colonialisme. La déposition de ces grandes figures intellectuelles a donné une brillante légitimation à la violence révolutionnaire à laquelle nous étions acculés. Durant 3 jours de débats de très haut niveau, j’étais, là, dans le box des accusés, à suivre, aux premières loges, comme un spectateur privilégié, des envolées lyriques à vous faire réfléchir sur le sort de l’humanité entière. Des questions philosophiques qui me concernaient directement et au premier chef. Quant à l’accusation, celle-ci voulait ma tête. Pas moins de deux anciens gouverneurs généraux de l’Algérie, en l’occurrence les sinistres Jacques Soustelle et Edmond Naegelen, ont été cités par la partie civile pour venir me charger.
Il y a de quoi en être fier ! (rires)
Toute modestie mise à part, ceci est à inscrire à la gloire de la Révolution algérienne. Même si, pour ma part, j’ai été très impressionné par la présence de tant d’éminentes personnalités dans la salle. C’est même grâce à ces célébrités que j’ai pu échapper de peu à la guillotine. Le procureur avait requis la peine capitale. J’ai finalement écopé d’une peine de réclusion à perpétuité à mon grand soulagement. À l’énoncé de la sentence, je me suis écrié à l’adresse de mon avocat, Maître Stibbe, quelque peu abattu par le verdict : «Vous m’avez sauvé la vie. Soyez sûr que l’Algérie sera bientôt libre et que je le serai moi aussi !»
Des paroles enthousiastes et prémonitoires, mais il s’ensuivra, quand même, cinq longues années d’incarcération avant l’indépendance du pays…
Oui, et je peux même dire, qu’à ce titre, j’ai fait le «Tour de France» des prisons, à savoir sept en tout, à commencer par le quartier de haute sécurité de la prison de Fresnes. Je peux citer également les prisons de La Santé, Foix, Toulouse, Rouen, Toul et Metz. En isolement total durant 4 ans et demi, j’ai eu le privilège d'occuper la cellule au double blindage de «Pierrot le Fou», un gangster longtemps considéré en France comme «ennemi public numéro 1».
Pourriez-vous nous raconter une anecdote que vous avez vécue durant votre séjour en prison ?
Un jour, j’ai reçu, au parloir, la visite du Professeur Louis Massignon, un orientaliste réputé. Il me parlait dans un arabe classique dont je n’avais pas compris un traître mot. Je l’ai alors interrompu en lui demandant de me parler simplement en français. Sur ce, mon visiteur a mis fin à la conversation et a aussitôt pris congé en me lâchant un abrupt «au revoir». Je venais de recevoir une gifle. J’avoue que j’en étais couvert de honte même si ce n’était pas de ma faute que mon pays ait subi une déculturation durant plus d’un siècle. Depuis, je me suis rattrapé — en prison même — pour apprendre cette langue que je pratique aujourd’hui correctement aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Mourir pour des idées, c’est finalement tuer aussi pour elles…
Sincèrement, je n’ai, à ce jour, aucun remords ni regret d’avoir abattu un félon et un traître à son pays. Quant à la mort, cela faisait longtemps que je la côtoyais. À 11 ans seulement, j’étais déjà un survivant, un miraculé. En 1942, mon école avait été bombardée par l’aviation italienne dans le sillage de l’attaque du port de Annaba qui ravitaillait alors les troupes du général Leclerc, stationnées en Tunisie. Ce jour-là, je n’étais pas allé en classe parce que ma mère m’avait envoyé chercher le pain qui était rationné à l’époque. Laissez-moi vous dire que 200 de mes camarades y ont succombé. Il me paraît inutile de vous préciser que, pour ladite opération, j’étais parti pour mourir.
Qui était Ali Chekkal
Originaire de Mascara, Ali Chekkal deviendra avocat, puis bâtonnier du barreau de sa ville natale. Il se lance en politique en 1944. Conseiller général de Mostaganem, puis élu à l’Assemblée algérienne, il en assume la vice-présidence en 1949. Sa dernière mission officielle l’a conduit à New York avec la délégation française à l’ONU.
Profondément attaché à la France, l’émir Chekkal, tel qu’affublé par la France coloniale, avait épousé une Française, la fille d’un capitaine originaire de Montpellier. Toutes ses activités, les derniers mois de son existence, ce francophile notoire les consacrera à défendre farouchement la cause de l’Algérie française. «En Algérie, il ne peut y avoir qu’un seul drapeau : celui de la France», répétait-il, inlassablement. Depuis son retour de New York où il est allé plaider une cause perdue d’avance, un service renforcé de protection rapprochée l’entourait dans tous ses déplacements que ce soit dans l’Oranie ou en France métropolitaine. À l’hôtel du Boulevard Haussmann où il résidait, chaque nuit, dans la chambre voisine de la sienne, un inspecteur veillait sur sa sécurité. Et c’est un membre de la préfecture de police qui tenait le volant de la voiture mise à sa disposition.
Le grand ami de la France disparu a été inhumé, en grande pompe, au cimetière de Thiais après avoir eu droit aux honneurs militaires au Val de Grâce où il lui a été décerné, à titre posthume, la médaille de vermeil de la Reconnaissance française. Lors de son témoignage en faveur de Bensadok, le philosophe Jean-Paul Sartre transformera le nom du traître Chekkal en «Chacal».
Un évènement historique immortalisé par la littérature
Que savons-nous de Mohamed Bensadok ? Pas grand-chose et ce, d’autant plus que l’historiographie concernant la Fédération de France du FLN, décrétée Wilaya 7, n’a pas toujours été très prolixe à son sujet. Qui est Mohamed Bensadok ? Pour ceux qui ne le savent pas, et ils sont fort nombreux, il est l’auteur d’une action spectaculaire qui a grandement servi la Révolution. On parle souvent de l’ouverture du deuxième front en France mais jamais suffisamment de la première action armée et de l’homme qui l’a menée avec succès. Il s’agit en l’occurrence d’un héros méconnu qui, durant le siècle passé, a fait le sacrifice de sa jeunesse pour l’indépendance du pays.
Mohamed Bensadok est un homme courageux, intègre et sincère qui n’a pas eu peur de risquer sa vie là où d’autres auraient préféré laisser tomber… Ces derniers, dont certains surmédiatisés à souhait, devraient s’astreindre aujourd’hui à une pause, à un «confinement» volontaire pour laisser s’exprimer enfin l’un de ceux qui ont gardé leur loyauté intacte à l'égard du peuple algérien martyr. C’est donc ce Mohamed Bensadok né le 31 août 1931 à Annaba qui a porté le premier coup bien asséné dans le ventre même de la bête, celui qui a étrenné avec dévouement une longue série d’actions sur le sol français. Un événement ou plutôt une action d’éclat qui a valu à la cause algérienne une médiatisation sans précédent à un moment décisif. C'était, en effet, la première fois dans l'Histoire de l’humanité qu'un mouvement indépendantiste perpétra des attaques sur le sol même du colonisateur.
D'abord, rappel des faits : dimanche 29 mai 1957. Au stade olympique de Colombes, à Paris, il y a la finale de la Coupe de France de football qui opposait l'équipe d'Angers à celle de Toulouse. Bensadok avait pour ordre formel d'abattre le traîre Ali Chekkal, vice-président de l'Assemblée algérienne, qui devait assister à la rencontre aux côtés du président de la République française René Coty. En menant avec succès cette première opération en territoire français, Bensadok venait de montrer au monde entier que le FLN était partout et qu’il était capable de frapper là où il voulait. Dans la confusion, la foule parisienne avait d’abord cru à l'assassinat du président de la République René Coty en personne.
Une rumeur qui a vite fait le tour de la capitale française avant d’être démentie le soir aux «actualités» diffusées par la télévision, un support qui venait de faire alors sa percée dans les foyers français. C’est dire qu’il fallait gagner aussi cette première bataille médiatique afin d'influencer l'opinion publique, les intellectuels et les milieux politiques français. Elle le sera doublement. Jugeons-en.
Lors du procès à la Cour d’assises de Paris en décembre 1957, la présence d’éminentes personnalités citées par la partie civile et par la défense donnera un nouveau retentissement à l’affaire. Maître Stibbe, avocat de Bensadok, cite à la barre des témoins prestigieux comme Germaine Tillon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Louis Massignon…
Le témoignage de Sartre en faveur de Bensadok fera date. Pour la partie civile, de farouches partisans de l’Algérie française ont été cités, à savoir Georges Bidault, Soustelle et Naegelen, anciens gouverneurs généraux de l’Algérie.
M. C.-L.