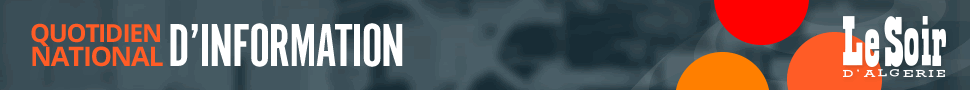Par le Dr Mourad Betrouni
Dans sa livraison du mardi 8 janvier 2019, le quotidien Le soir d’Algérie a publié, en page 10, un papier qui fait état de la «classification de près de 1000 monuments à travers le territoire national». Ce papier a attiré notr...