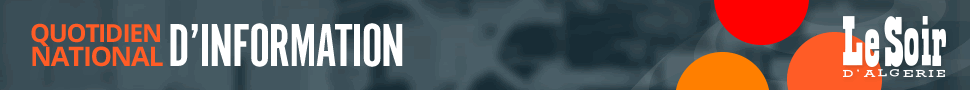Pour son premier roman, Maya Boutaghou fait appel au réalisme et à la
profondeur psychologique dans la mise en scène de ses personnages. Cela
lui permet de représenter les mutations sociales et la vie urbaine selon
une vision profondément photographique.
Témoin attentif, la romancière exprime, par exemple, ce contraste : «Il faut marcher seul à Alger pour comprendre l’absence de cohérence, le désordre, ce que Lamia avait très vite oublié en vivant en Europe (...). Ici, le monde acceptait l’absurde, l’incohérence, on faisait avec, le plus urgent était de survivre. Bien qu’elle ait perdu, en vivant en France, l’habitude du désordre, elle n’avait pas de peine à la retrouver ici dans son lieu ; elle procédait à une translation mentale, changeait les contraintes des situations les plus simples comme traverser la rue sans attendre le feu vert piétons, mais que l’occasion se présente entre deux flots de voitures et qu’un espace pour les marcheurs se forme spontanément. Elle apprenait à nouveau à vivre dans l’absence de règles, ou alors dans un espace de règles improvisées, établies par la foule en mouvement qui allait parfois, sans peur, vers la mort.» Lamia, le personnage principal, a fait le «Voyage d’Alger» au début des années 2000. La jeune femme «était venue revoir sa plus vieille amie. Elle gardait l’obstination des amnésiques dont on dit qu’ils veulent désespérément reconstruire leur mémoire à partir d’un moment de leur vie». Reconstruire sa mémoire en s’imbibant d’Alger, cette vieille amie, c’était aussi travailler sur un projet de livre, de photographies et textes car, pour l’exilée, «seule la ville continuait à la séduire, à lui parler sans bavarder». Lamia Mohend, 35 ans, est de retour dans sa ville natale après des années d’absence. Comme tant d’autres, elle s’était réfugiée en France durant la décennie noire. «Je travaille à l’université de Toulouse, j’ai dû refaire un troisième cycle, j’ai eu beaucoup de chance de trouver du travail, mais je ne suis pas encore mariée, je crois que c’est trop tard maintenant. Je suis rentrée pour reprendre des contacts maintenant que ça va mieux, j’aimerais faire le va-et-vient», explique-t-elle à une ancienne voisine. Retrouvailles avec les gens de son milieu, c’est-à-dire ceux de la classe moyenne moderniste.
D’ailleurs, Lamia et sa sœur Rym «fréquentaient des gens aussi libres qu’elles et ne supportaient pas de revenir sur certains acquis, comme sortir le soir, s’habiller librement, aller à la piscine avec des copains, rigoler à la plage et d’autres comportements vivement désapprouvés dans d’autres familles algériennes».
Ces familles traditionnalistes diront de Lamia et de ses connaissances que ce sont des gens trop libres, trop indépendants, trop occidentalisés. Le Voyage d’Alger, c’est donc un travail littéraire qui est à la fois reconstruction, recomposition de souvenirs et représentation d’une réalité que vivent des individus appartenant à une classe sociale bien distincte.
Dans ce roman «identitaire», nous sommes à la fois dedans et dehors, en ce sens que les scènes réalistes de la vie urbaine se déroulent dans une ambiance métaphysique, voire ontologique.
Les personnages se retrouvent, partent des émotions, des plaisirs et des joies, mais leurs relations avec les autres font transparaître la mélancolie, la tension, la solitude, l’incompréhension, le silence, la frustration, les désirs refoulés, voire la névrose. Entre ce que les personnages montrent à la société et ce qui ne peut être exprimé (tout ce qui est en dedans et dont le récit invite à une introspection attentive), il y a tout un univers psychologique que la profondeur du champ de l’objectif photographique enregistre néanmoins dans toute sa netteté. Par exemple, Lamia a renoué sa liaison amoureuse avec Sofien, lui aussi ancien étudiant. Pourtant, tous deux semblent esseulés et mélancoliques. C’est l’impression que donnent certaines images, notamment la suivante : «Ils s’assirent, Lamia alluma une cigarette et, tout en écoutant le mouvement de l’eau sur le sable, elle attendait que Sofien lui dise quelque chose, quelque chose qui résoudrait toutes ses peurs, mais Sofien ne pouvait rien dire, il regardait le mouvement de l’eau, la lumière des bateaux au loin ; de temps en temps, il fumait quelques bouffées de la cigarette de Lamia. Ils se tenaient par la main et ils tremblaient tous les deux (...). Rien ne pouvait se produire, aucun évènement ne pouvait rompre leur silence, ils se contentaient d’écouter le bruit de la mer sur le sable, et leur souffle.» La jeune femme libérée ne pourra pas se défendre d’un sentiment pénible et irraisonné. Un certain malaise l’accompagnera tout au long de ses retrouvailles avec la ville : «Le malaise revenait doucement, au détour d’une conversation, dans le regard des gens, au milieu de la foule, mais aussi, parfois, dans le chaos des interdits plus ou moins conscients, des rencontres qui se produisaient. Elle avait alors envie de vivre là, parmi eux, au sein de la contradiction ; et puis non, décidément, renoncer à sa liberté était impossible.»
Dans cet autre passage (cette fois-ci en italique), l’introspection qui permet de se concentrer sur son intériorité se réfère au symbole de la lumière : «Ici, dans sa ville, rien ne paraissait être au présent, le souvenir attirait à lui tous les instants. Et même la lumière aveuglante n’était vue que depuis le filtre trouble du passé. Le présent avait quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle se sentait l’image d’une autre qui, pourtant, ne pouvait être qu’elle ; elle, l’image vieillie d’une très jeune femme dont elle ne reconnaissait plus la voix.» Les passages en caractère italique représentent des haltes régulières, des pauses nécessaires pour mieux communiquer avec son être intérieur et avec le souffle qui anime, inspire, crée. Une sorte de solitude volontaire ? Pour échapper à quoi ? Peut-être à cette «force qui pousse les gens dans la rue tous les jours, sans que la succession des jours apporte quelque chose de différent de ce qui s’y trouve déjà. Une sorte de ‘’goulag’’ national, sur plusieurs millions de kilomètres carrés et, en face de la mer, derrière la montagne et le désert, au milieu, des gens qui tournent dans des cellules dont ils ne savent même plus qu’elles existent. Cet enfermement lui faisait horreur.
Une maladie partagée qui, même dans l’exil, était difficile à oublier, on portait cette tare avec soi. Et pourtant elle voyageait, elle était libre, mais elle savait qu’elle devait toujours être attentive aux risques des prisons mentales». Ah ! les «prisons mentales». La nostalgie des vertes années et des moments de bonheur vécus à Alger, pouvait-elle être d’un quelconque secours ? Le travail de mémoire, le ressourcement, les images, les odeurs, ou encore l’effort de renouer avec un amour passé peuvent-ils influer sur le destin ? Celle qui est rentrée dans son pays, dans sa ville et que personne ne reconnaît plus vraiment (sa propre mère estime qu’elle est «trop occidentalisée») se reconnaît-elle elle-même ? Avec ce «Voyage d’Alger», «que saurait-elle de plus aujourd’hui ? (...) Il n’y avait rien de plus à savoir, rien d’autre à chercher là, ici et maintenant, avant de partir, repartir, s’éloigner. Tout ce qu’elle devait savoir, elle l’avait probablement déjà su. (...) Alors que venait-elle chercher, puisqu’elle savait tout ce qu’elle devait savoir ? Que pouvait-elle répondre à ce face à face avec son éloignement de plus en plus éloigné de sa présence ici maintenant d’une image qui ne saurait jamais être sienne à présent ? Elle ne pouvait que se regarder être devenue autre» (italique). Quête. Désenchantement. Incommunicabilité. Mélancolie. Solitude. Images d’Alger et des mutations sociales en ce début du XXIe siècle. L’indicible qui devient le mouvement même des scènes, des situations et du chassé-croisé polyphonique qui, finalement, n’aide pas le personnage principal à s’orienter dans «la ville-brouillon».
Pour Lamia Mohend, il ne «restait que l’ennui». Elle avait tenté, mais la virée «photographique» lui avait laissé comme un goût de cendre. A la fin, elle décida «de laisser le temps passer, après tout, c’était mieux ainsi».
Maya Boutaghou a réalisé une œuvre romanesque singulière et forte. On devine qu’elle s’est inspirée de son propre vécu pour représenter Alger et donner de la profondeur psychologique aux personnages qu’elle met en scène dans leurs relations avec les autres. Un «autoportrait» par bien des aspects et qu’elle a réussi, grâce à l’art de la transposition, du dialogue, du monologue intérieur à la troisième personne et à des descriptions objectives.
C’est aussi pour cela que le voyage dans la métropole algéroise se déroule dans l’intime, dans l’anonymat, avec une farandole de personnages (surtout féminins) qui peuvent ressembler à tout sauf à des héros.
Hocine Tamou
Maya Boutaghou, Voyage d’Alger, Aframed éditions, Alger 2019, 206 pages.
Témoin attentif, la romancière exprime, par exemple, ce contraste : «Il faut marcher seul à Alger pour comprendre l’absence de cohérence, le désordre, ce que Lamia avait très vite oublié en vivant en Europe (...). Ici, le monde acceptait l’absurde, l’incohérence, on faisait avec, le plus urgent était de survivre. Bien qu’elle ait perdu, en vivant en France, l’habitude du désordre, elle n’avait pas de peine à la retrouver ici dans son lieu ; elle procédait à une translation mentale, changeait les contraintes des situations les plus simples comme traverser la rue sans attendre le feu vert piétons, mais que l’occasion se présente entre deux flots de voitures et qu’un espace pour les marcheurs se forme spontanément. Elle apprenait à nouveau à vivre dans l’absence de règles, ou alors dans un espace de règles improvisées, établies par la foule en mouvement qui allait parfois, sans peur, vers la mort.» Lamia, le personnage principal, a fait le «Voyage d’Alger» au début des années 2000. La jeune femme «était venue revoir sa plus vieille amie. Elle gardait l’obstination des amnésiques dont on dit qu’ils veulent désespérément reconstruire leur mémoire à partir d’un moment de leur vie». Reconstruire sa mémoire en s’imbibant d’Alger, cette vieille amie, c’était aussi travailler sur un projet de livre, de photographies et textes car, pour l’exilée, «seule la ville continuait à la séduire, à lui parler sans bavarder». Lamia Mohend, 35 ans, est de retour dans sa ville natale après des années d’absence. Comme tant d’autres, elle s’était réfugiée en France durant la décennie noire. «Je travaille à l’université de Toulouse, j’ai dû refaire un troisième cycle, j’ai eu beaucoup de chance de trouver du travail, mais je ne suis pas encore mariée, je crois que c’est trop tard maintenant. Je suis rentrée pour reprendre des contacts maintenant que ça va mieux, j’aimerais faire le va-et-vient», explique-t-elle à une ancienne voisine. Retrouvailles avec les gens de son milieu, c’est-à-dire ceux de la classe moyenne moderniste.
D’ailleurs, Lamia et sa sœur Rym «fréquentaient des gens aussi libres qu’elles et ne supportaient pas de revenir sur certains acquis, comme sortir le soir, s’habiller librement, aller à la piscine avec des copains, rigoler à la plage et d’autres comportements vivement désapprouvés dans d’autres familles algériennes».
Ces familles traditionnalistes diront de Lamia et de ses connaissances que ce sont des gens trop libres, trop indépendants, trop occidentalisés. Le Voyage d’Alger, c’est donc un travail littéraire qui est à la fois reconstruction, recomposition de souvenirs et représentation d’une réalité que vivent des individus appartenant à une classe sociale bien distincte.
Dans ce roman «identitaire», nous sommes à la fois dedans et dehors, en ce sens que les scènes réalistes de la vie urbaine se déroulent dans une ambiance métaphysique, voire ontologique.
Les personnages se retrouvent, partent des émotions, des plaisirs et des joies, mais leurs relations avec les autres font transparaître la mélancolie, la tension, la solitude, l’incompréhension, le silence, la frustration, les désirs refoulés, voire la névrose. Entre ce que les personnages montrent à la société et ce qui ne peut être exprimé (tout ce qui est en dedans et dont le récit invite à une introspection attentive), il y a tout un univers psychologique que la profondeur du champ de l’objectif photographique enregistre néanmoins dans toute sa netteté. Par exemple, Lamia a renoué sa liaison amoureuse avec Sofien, lui aussi ancien étudiant. Pourtant, tous deux semblent esseulés et mélancoliques. C’est l’impression que donnent certaines images, notamment la suivante : «Ils s’assirent, Lamia alluma une cigarette et, tout en écoutant le mouvement de l’eau sur le sable, elle attendait que Sofien lui dise quelque chose, quelque chose qui résoudrait toutes ses peurs, mais Sofien ne pouvait rien dire, il regardait le mouvement de l’eau, la lumière des bateaux au loin ; de temps en temps, il fumait quelques bouffées de la cigarette de Lamia. Ils se tenaient par la main et ils tremblaient tous les deux (...). Rien ne pouvait se produire, aucun évènement ne pouvait rompre leur silence, ils se contentaient d’écouter le bruit de la mer sur le sable, et leur souffle.» La jeune femme libérée ne pourra pas se défendre d’un sentiment pénible et irraisonné. Un certain malaise l’accompagnera tout au long de ses retrouvailles avec la ville : «Le malaise revenait doucement, au détour d’une conversation, dans le regard des gens, au milieu de la foule, mais aussi, parfois, dans le chaos des interdits plus ou moins conscients, des rencontres qui se produisaient. Elle avait alors envie de vivre là, parmi eux, au sein de la contradiction ; et puis non, décidément, renoncer à sa liberté était impossible.»
Dans cet autre passage (cette fois-ci en italique), l’introspection qui permet de se concentrer sur son intériorité se réfère au symbole de la lumière : «Ici, dans sa ville, rien ne paraissait être au présent, le souvenir attirait à lui tous les instants. Et même la lumière aveuglante n’était vue que depuis le filtre trouble du passé. Le présent avait quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle se sentait l’image d’une autre qui, pourtant, ne pouvait être qu’elle ; elle, l’image vieillie d’une très jeune femme dont elle ne reconnaissait plus la voix.» Les passages en caractère italique représentent des haltes régulières, des pauses nécessaires pour mieux communiquer avec son être intérieur et avec le souffle qui anime, inspire, crée. Une sorte de solitude volontaire ? Pour échapper à quoi ? Peut-être à cette «force qui pousse les gens dans la rue tous les jours, sans que la succession des jours apporte quelque chose de différent de ce qui s’y trouve déjà. Une sorte de ‘’goulag’’ national, sur plusieurs millions de kilomètres carrés et, en face de la mer, derrière la montagne et le désert, au milieu, des gens qui tournent dans des cellules dont ils ne savent même plus qu’elles existent. Cet enfermement lui faisait horreur.
Une maladie partagée qui, même dans l’exil, était difficile à oublier, on portait cette tare avec soi. Et pourtant elle voyageait, elle était libre, mais elle savait qu’elle devait toujours être attentive aux risques des prisons mentales». Ah ! les «prisons mentales». La nostalgie des vertes années et des moments de bonheur vécus à Alger, pouvait-elle être d’un quelconque secours ? Le travail de mémoire, le ressourcement, les images, les odeurs, ou encore l’effort de renouer avec un amour passé peuvent-ils influer sur le destin ? Celle qui est rentrée dans son pays, dans sa ville et que personne ne reconnaît plus vraiment (sa propre mère estime qu’elle est «trop occidentalisée») se reconnaît-elle elle-même ? Avec ce «Voyage d’Alger», «que saurait-elle de plus aujourd’hui ? (...) Il n’y avait rien de plus à savoir, rien d’autre à chercher là, ici et maintenant, avant de partir, repartir, s’éloigner. Tout ce qu’elle devait savoir, elle l’avait probablement déjà su. (...) Alors que venait-elle chercher, puisqu’elle savait tout ce qu’elle devait savoir ? Que pouvait-elle répondre à ce face à face avec son éloignement de plus en plus éloigné de sa présence ici maintenant d’une image qui ne saurait jamais être sienne à présent ? Elle ne pouvait que se regarder être devenue autre» (italique). Quête. Désenchantement. Incommunicabilité. Mélancolie. Solitude. Images d’Alger et des mutations sociales en ce début du XXIe siècle. L’indicible qui devient le mouvement même des scènes, des situations et du chassé-croisé polyphonique qui, finalement, n’aide pas le personnage principal à s’orienter dans «la ville-brouillon».
Pour Lamia Mohend, il ne «restait que l’ennui». Elle avait tenté, mais la virée «photographique» lui avait laissé comme un goût de cendre. A la fin, elle décida «de laisser le temps passer, après tout, c’était mieux ainsi».
Maya Boutaghou a réalisé une œuvre romanesque singulière et forte. On devine qu’elle s’est inspirée de son propre vécu pour représenter Alger et donner de la profondeur psychologique aux personnages qu’elle met en scène dans leurs relations avec les autres. Un «autoportrait» par bien des aspects et qu’elle a réussi, grâce à l’art de la transposition, du dialogue, du monologue intérieur à la troisième personne et à des descriptions objectives.
C’est aussi pour cela que le voyage dans la métropole algéroise se déroule dans l’intime, dans l’anonymat, avec une farandole de personnages (surtout féminins) qui peuvent ressembler à tout sauf à des héros.
Hocine Tamou
Maya Boutaghou, Voyage d’Alger, Aframed éditions, Alger 2019, 206 pages.