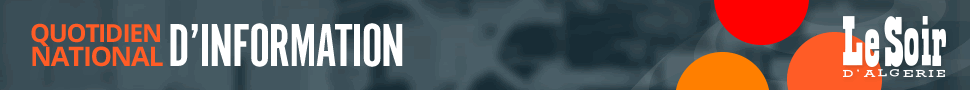Hiroo Onoda était un soldat japonais qui, en 1944, pendant la Seconde
Guerre mondiale, avait été envoyé aux Philippines plombé par un ordre
formel : ne jamais se rendre ! Isolé sur une île, il ne crut pas à la
fin de la guerre et continua, pendant 30 ans, des opérations de
guérilla. Elles durèrent ... jusqu’en 1974.
Au vrai, ils étaient quelques-uns dans son cas lors de la Guerre du Pacifique. Ils ne surent pas, ou refusèrent d’admettre, que le Japon avait capitulé et que l’ordre nouveau était celui du vainqueur, les États-Unis. On les appelle les straggler (« traînards »).
Quel rapport avec Evo Morales, l’ex-Président de gauche de Bolivie ? Comme Castro, Chavez, Lula, Maduro, Evo Morales est-il un straggler qui ignore que la Guerre froide est finie depuis la chute du Mur de Berlin et que l’ordre nouveau, ultralibéral et antisocial, est celui du vainqueur qui, comme pour l’époque de Hiroo Onoda, sont les États-Unis ? Évidemment, la comparaison est juste d’ordre métaphorique. Rien à voir entre le Japon impérial qui s’est rangé aux côtés des forces nazies et fascistes et les pays socialistes.
Comme ses pairs de gauche que le système démocratique du scrutin a portés au pouvoir en Amérique du Sud, Evo Morales a réussi une double prouesse. Il a su contenir les forces conservatrices alliées à l’impérialisme d’un côté, et a osé, d’un autre côté, la gageure d’une politique de gauche sur les décombres du socialisme discrédité, devenu synonyme d’échec et attribut de dictature.
En dépit de ce double handicap martelé en boucle par les grands moyens de communication de la mondialisation qui distribuent les grades de démocrates et les quolibets de dictateurs, en dépit de sa notoriété de pourfendeur impavide de l’impérialisme américain, il accède, en 2006, à la présidence dans un sous-continent corseté par les intérêts étasuniens. Il sera le premier Président d’origine amérindienne de Bolivie.
Né en 1959 à Orinaca, ville minière de l’Alti Plato bolivien, Evo Morales est fils de paysans indiens Ayamara (un peuple originaire de la région du lac Titicaca).
De condition modeste, il arrête tôt sa scolarité pour gagner sa vie comme trompettiste. Son expérience, par la suite, du travail en tant que cultivateur dans la zone tropicale du Chapare accentue sa conscience des injustices subies par les Indiens exploitants de coca. Il décide alors de se battre dans le syndicalisme pour défendre ces petits planteurs de coca. Puis il s’engage en politique en fondant son propre parti, le MAS (Mouvement vers le socialisme). Son programme — de gauche, évidemment — est tout tracé : alphabétisation, lutte contre la pauvreté et la mortalité infantile, distribution de bons scolaires aux foyers pauvres, redistribution des terres.
Dès son élection, en 2006, il pousse d’un cran la résistance au capitalisme mondialisé en annonçant sa volonté de toucher au saint du saint, nationaliser les entreprises d’exploitation de ressources naturelles, celles procédant de l’industrie gazière et pétrolière surtout. Le succès de sa politique sociale reposait sur l’usage des revenus tirés des matières premières au bénéfice de l’émancipation sociale des couches les plus pauvres de la société bolivienne. Pareille décision était insupportable pour les multinationales et les forces de l’argent.
S’il fait montre d’intransigeance dans la défense des intérêts de son peuple, Evo Morales est aussi un passionné dont les élans déstabilisent ses adversaires. En avril 2009, pour protester contre le blocage d’une loi électorale qu’il proposait au Parlement, il lança sa propre grève de la faim afin de faire pression sur le Congrès. L’hostilité de la coalition de la droite bolivienne avec les forces de la mondialisation financière finit par le faire démissionner en novembre 2019 sous l’accusation de fraude électorale. Il s’exile pendant un an en Argentine. Mais Luis Arce, son ex-ministre de l’Economie et ancien directeur de la Banque centrale bolivienne, est élu Président le 18 octobre 2020 avec 55% des voix, dès le premier tour. C’est la victoire du MAS de Morales.
Ce dernier quitte son exil argentin pour rentrer en Bolivie, accompagné d’un convoi de « 800 véhicules ».
Diabolisé, marginalisé, voué aux gémonies, Evo Morales garde le sens du symbole fort en traversant à pied, dès l’annonce de cette victoire, le pont transfrontalier qui relie l’Argentine à la Bolivie. Des milliers de ses partisans l’accueillent en brandissant la Wiphala, le drapeau multicolore des peuples indigènes. Cet emblème était déjà celui de Túpac Katari, le rebelle aymara démembré en 1751 à La Paz pour avoir défié l’autorité coloniale espagnole. Au moment de son départ, ce dernier lança : « Je reviendrai et je serai des millions.»
La promesse a servi, en 2005, de slogan électoral à Evo Morales.
L’élection de Luis Arce, architecte de la politique économique d’Evo Morales, est différemment appréhendée. Si elle est accueillie avec ferveur par les indigènes des montagnes, ce n’est pas du tout le cas dans les milieux politiques de la capitale sonnés par ce retour de la gauche au pouvoir. Ils n’acceptent pas cette sanction infligée à la droite aux affaires qui n’a pas su gérer la crise de Covid. S’y ajoute l’effet d’une nostalgie en ces temps troubles : la stabilité politique et économique de la période Evo Morales !
Le nouveau Président s’est senti obligé de préciser qu’il n’allait pas gouverner par procuration pour Evo Morales. D’ailleurs, ce dernier se défend de tout retour à la politique. Ses projets ? Créer des fermes piscicoles au Chapare, sa région natale . Mais pas seulement. Ouvrir aussi un restaurant où l’on chanterait les chansons à la gloire du parti de Morales. Il a réuni un répertoire de trois cents chansons. Il est lui-même auteur de l’une d’entre elles.
Le fait est qu’un président ouvertement de gauche est élu en Bolivie. C’est à méditer en ces temps de triomphe absolu de l’ultralibéralisme qui survit même à cette crise sanitaire à laquelle, indirectement, il a mené.
A. M.
Au vrai, ils étaient quelques-uns dans son cas lors de la Guerre du Pacifique. Ils ne surent pas, ou refusèrent d’admettre, que le Japon avait capitulé et que l’ordre nouveau était celui du vainqueur, les États-Unis. On les appelle les straggler (« traînards »).
Quel rapport avec Evo Morales, l’ex-Président de gauche de Bolivie ? Comme Castro, Chavez, Lula, Maduro, Evo Morales est-il un straggler qui ignore que la Guerre froide est finie depuis la chute du Mur de Berlin et que l’ordre nouveau, ultralibéral et antisocial, est celui du vainqueur qui, comme pour l’époque de Hiroo Onoda, sont les États-Unis ? Évidemment, la comparaison est juste d’ordre métaphorique. Rien à voir entre le Japon impérial qui s’est rangé aux côtés des forces nazies et fascistes et les pays socialistes.
Comme ses pairs de gauche que le système démocratique du scrutin a portés au pouvoir en Amérique du Sud, Evo Morales a réussi une double prouesse. Il a su contenir les forces conservatrices alliées à l’impérialisme d’un côté, et a osé, d’un autre côté, la gageure d’une politique de gauche sur les décombres du socialisme discrédité, devenu synonyme d’échec et attribut de dictature.
En dépit de ce double handicap martelé en boucle par les grands moyens de communication de la mondialisation qui distribuent les grades de démocrates et les quolibets de dictateurs, en dépit de sa notoriété de pourfendeur impavide de l’impérialisme américain, il accède, en 2006, à la présidence dans un sous-continent corseté par les intérêts étasuniens. Il sera le premier Président d’origine amérindienne de Bolivie.
Né en 1959 à Orinaca, ville minière de l’Alti Plato bolivien, Evo Morales est fils de paysans indiens Ayamara (un peuple originaire de la région du lac Titicaca).
De condition modeste, il arrête tôt sa scolarité pour gagner sa vie comme trompettiste. Son expérience, par la suite, du travail en tant que cultivateur dans la zone tropicale du Chapare accentue sa conscience des injustices subies par les Indiens exploitants de coca. Il décide alors de se battre dans le syndicalisme pour défendre ces petits planteurs de coca. Puis il s’engage en politique en fondant son propre parti, le MAS (Mouvement vers le socialisme). Son programme — de gauche, évidemment — est tout tracé : alphabétisation, lutte contre la pauvreté et la mortalité infantile, distribution de bons scolaires aux foyers pauvres, redistribution des terres.
Dès son élection, en 2006, il pousse d’un cran la résistance au capitalisme mondialisé en annonçant sa volonté de toucher au saint du saint, nationaliser les entreprises d’exploitation de ressources naturelles, celles procédant de l’industrie gazière et pétrolière surtout. Le succès de sa politique sociale reposait sur l’usage des revenus tirés des matières premières au bénéfice de l’émancipation sociale des couches les plus pauvres de la société bolivienne. Pareille décision était insupportable pour les multinationales et les forces de l’argent.
S’il fait montre d’intransigeance dans la défense des intérêts de son peuple, Evo Morales est aussi un passionné dont les élans déstabilisent ses adversaires. En avril 2009, pour protester contre le blocage d’une loi électorale qu’il proposait au Parlement, il lança sa propre grève de la faim afin de faire pression sur le Congrès. L’hostilité de la coalition de la droite bolivienne avec les forces de la mondialisation financière finit par le faire démissionner en novembre 2019 sous l’accusation de fraude électorale. Il s’exile pendant un an en Argentine. Mais Luis Arce, son ex-ministre de l’Economie et ancien directeur de la Banque centrale bolivienne, est élu Président le 18 octobre 2020 avec 55% des voix, dès le premier tour. C’est la victoire du MAS de Morales.
Ce dernier quitte son exil argentin pour rentrer en Bolivie, accompagné d’un convoi de « 800 véhicules ».
Diabolisé, marginalisé, voué aux gémonies, Evo Morales garde le sens du symbole fort en traversant à pied, dès l’annonce de cette victoire, le pont transfrontalier qui relie l’Argentine à la Bolivie. Des milliers de ses partisans l’accueillent en brandissant la Wiphala, le drapeau multicolore des peuples indigènes. Cet emblème était déjà celui de Túpac Katari, le rebelle aymara démembré en 1751 à La Paz pour avoir défié l’autorité coloniale espagnole. Au moment de son départ, ce dernier lança : « Je reviendrai et je serai des millions.»
La promesse a servi, en 2005, de slogan électoral à Evo Morales.
L’élection de Luis Arce, architecte de la politique économique d’Evo Morales, est différemment appréhendée. Si elle est accueillie avec ferveur par les indigènes des montagnes, ce n’est pas du tout le cas dans les milieux politiques de la capitale sonnés par ce retour de la gauche au pouvoir. Ils n’acceptent pas cette sanction infligée à la droite aux affaires qui n’a pas su gérer la crise de Covid. S’y ajoute l’effet d’une nostalgie en ces temps troubles : la stabilité politique et économique de la période Evo Morales !
Le nouveau Président s’est senti obligé de préciser qu’il n’allait pas gouverner par procuration pour Evo Morales. D’ailleurs, ce dernier se défend de tout retour à la politique. Ses projets ? Créer des fermes piscicoles au Chapare, sa région natale . Mais pas seulement. Ouvrir aussi un restaurant où l’on chanterait les chansons à la gloire du parti de Morales. Il a réuni un répertoire de trois cents chansons. Il est lui-même auteur de l’une d’entre elles.
Le fait est qu’un président ouvertement de gauche est élu en Bolivie. C’est à méditer en ces temps de triomphe absolu de l’ultralibéralisme qui survit même à cette crise sanitaire à laquelle, indirectement, il a mené.
A. M.