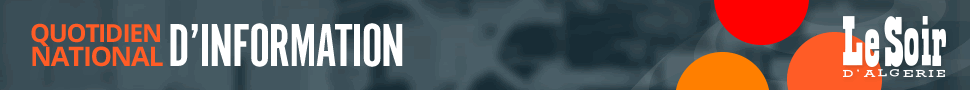Assis comme d’habitude sur son banc préféré au square d’El Khemis, Bachir lisait tranquillement son journal quand trois jeunes s’installèrent près de lui. Ils le saluèrent et commencèrent à palabrer, empêchant ainsi leur voisin de se concentrer sur sa lecture. Il plia son quotidien, le déposa sur ses genoux et attendit patiemment leur départ pour se remettre à lire.
Il patienta pendant plus de trente minutes sans rien dire, mais quand il entendit un des adolescents prononcer la phrase «le bon vieux temps», il sortit de ses gonds pour questionner le blanc-bec.
- De quel vieux temps veux-tu parler mon garçon ?
- De celui de mon père et de mon grand-père, ils disent qu’avant c’était mieux.
- Ils doivent vivre sur une autre planète que la mienne, car moi qui viens de boucler mes soixante-dix ans cette année, et je ne l’ai jamais connu ce bon vieux temps.
- Sauf votre respect Monsieur, il n’y a pas que mes parents qui regrettent la période d’après-l’indépendance.
- Ce sont de fieffés menteurs, je vous le confirme et si vous avez du temps à me consacrer, je vais vous faire vivre ce bon vieux temps comme si vous y étiez.
- Nous sommes tout ouïe cheikh, répondirent les trois jeunes en chœur.
- Ouvrez vos oreilles et allons-y pour cette visite guidée et un flash-back.
«En 1962, j’avais quatorze ans, ce que je portais sur le dos et aux pieds me fera passer pour un clochard d’aujourd’hui, mon pantalon était rapiécé devant et derrière, mon pull bouloché et mes sandales en nylon trouées laissaient apparaître mes grands orteils.
A cette époque, je passais inaperçu, puisque les jeunes de mon âge étaient habillés comme moi, à se dire que la pauvreté était contagieuse. Les riches que je connaissais se comptaient sur les doigts d’une seule main, alors qu’aujourd’hui, il est pratiquement impossible de les dénombrer.
Question nourriture aussi, si vous invitez un mendiant et que vous lui servez la nourriture que j’étais obligé d’ingurgiter sans piper mot, il vous la jetera à la figure avant de détaler et de ne plus jamais s’approcher de votre porte. Il conseillera même à ses compagnons de rue d’en faire autant !
La nourriture d’une journée standard se résume à : un petit-déjeuner composé de café mélangé avec une cuillère de lait concentré, un bout de pain (il était précieux à l’époque pas comme aujourd’hui où toutes les poubelles en regorgent) ou d’une boulette de semoule (aâsbane en kabyle) de la veille.
A midi, dans ma soupe ne flottent que des morceaux de navet et deux ou trois de pomme de terre. Quand j’arrivais à en choper un avec ma fourchette, je le gardais un petit moment dans la bouche afin d’en savourer la consistance et le goût. Au dîner, le menu se composait d’un des plats suivants : aâsbane, couscous, berkoukes (sorte de gros grains de couscous) ou aftir ou qassoul (de longs rubans de pâte) et cela en boucle durant toute l’année.
Mon père apportait de la viande ou du poulet, jamais les deux à la fois, qu’une fois par mois, même les œufs étaient un luxe chez nous. Pour en avoir trois ou quatre pour moi seul, il fallait que j’attende le début du printemps quand ma mère nous préparait, comme tous les ans, un couscous cuit à la vapeur n uderyis, des racines aux mille vertus thérapeutiques qu’on appelait le vaccin kabyle. Ce plat est délicieux avec plein de fèves sèches, de pois chiches et une couche de sucre glace qui recouvre le tout, mais comme cette plante est toxique, interdiction de boire durant douze heures après le repas. Seule une orange est permise pour étancher la soif.
Après avoir brièvement survolé l’habillement et la nourriture, je passe à l’électroménager et aux ustensiles de cuisine préhistoriques de l’époque. Nous n’avions pas d’électricité donc pas de réfrigérateur ni de congélateur ; quand il nous restait un peu de viande après l’Aïd El Adha, on en faisait du qadide, on la salait et laissait sécher. C’était notre unique moyen de conservation. Comme gasinière, nous ne disposions que d’un réchaud à pétrole qu’il fallait amorcer avec de l’alcool à brûler et user de la pompe située sur son flanc durant un bon moment avant de voir apparaître la flamme. Pour ceux qui habitaient la campagne, la cuisson se faisait au feu de bois.
Le soir, c’est à la lueur d’un quinquet, kenki (lampe à pétrole) ou de bougies que je dînais et faisais mes devoirs.
En hiver, quand il fait un froid à vous geler le sang, je n’avais que le kanoun (une sorte de pot de fleurs en argile) pour me réchauffer. Il fallait que je me fasse une place entre mes frères et sœurs. Nous restions serrés, collés les uns aux autres pour tirer un maximum de chaleur de cette insignifiante source d’énergie. Le charbon de bois nous servait de combustible. Il se dégageait une fumée noirâtre qui brûle les yeux et irrite la gorge. En ce qui concerne les loisirs, nous n’avions que trois cinémas pour toute la ville ; lorsqu’un film intéressant est projeté, c’est le rush vers le guichet. Il fallait avoir des biscoteaux pour se procurer un billet ou avoir les moyens d’acheter son ticket au marché noir. J’ai raté plusieurs péplums et westerns à cause de cela.
Pour voir une rencontre de foot, c’était pareil, il n’y avait que le stade Benallouache à Béjaïa. Pour les fauchés comme moi, deux solutions s’offraient à nous : sauter par-dessus le mur au risque de tomber entre les mains des vigiles et se faire tabasser, ou attendre la mi-temps quand l’entrée devient gratuite.
La télé n’a fait son apparition chez nous que vers les années soixante, seuls certains commerçants pouvaient se payer cette merveilleuse petite lucarne. Je me rappelle avoir suivi la Coupe du monde 1970 au café Belhoucine assis sur un banc fabriqué avec un madrier posé sur des parpaings. Nous étions tellement nombreux que le patron des lieux a été obligé de sortir la boîte magique dehors. Je me souviens que le score final entre le Brésil et l’Italie était de 4 à 1 en faveur de l’équipe de Pelé.
Rares sont les familles qui possédaient le téléphone. C’était la galère pour communiquer, il fallait à chaque fois se déplacer. Dans le domaine de la santé aussi ce n’était pas la joie. Pour les circoncisions de mes frères et moi, mon père faisait appel à Mohand Oulouâar, il arrivait avec ses ciseaux et directement couic, et cela sans anesthésie, juste du mercurochrome, un peu de poudre blanche, une compresse et un pansement sur la plaie et au revoir ! On souffrait durant des jours souvent en silence.
Quand une dent nous empoisonnait la vie et qu’on voulait s’en débarrasser une bonne fois pour toutes, on évitait de se rendre au cabinet du seul dentiste de la ville qui avait la réputation d’être un vrai tortionnaire ; de plus, il fallait payer pour le supplice subi.
On préférait confier notre mâchoire à Ahmed ou Moussa, un grand monsieur à la carrure imposante, qui tenait une épicerie sur la route menant à Houma Oubazine, ce dernier nous faisait asseoir entre ses jambes et à l’aide de sa pince, seul instrument en sa possession, tel un prestidigitateur, il arrivait à nous soulager sans trop nous martyriser et cerise sur le gâteau, c’était gratuit.
Lorsqu’on tombait malade, comme il n’y avait pas beaucoup de médecins, trois ou quatre pour toute la ville, les salles d’attente étaient toujours archicombles, on attendait durant des heures, souvent assis par terre quand toutes les chaises étaient occupées, avant d’espérer voir le docteur.
Passant aux moyens de transport de l’époque. Pour voyager, il fallait avoir les reins solides et s’armer de patience. Je me souviens que pour me rendre à Amizour, à vingt-cinq kilomètres de Béjaïa, je choisissais toujours celui d’Ouallouche pour l’unique et simple raison qu’il était le moins cher, mais aussi le plus vétuste. Le receveur entassait ses voyageurs comme des sardines, il acceptait à l’intérieur de cet ancêtre des bus de petits animaux tels que des chevreaux, des agneaux, de la volaille, des sacs de blé, d’orge, des bidons d’huile d’olive… Cet ensemble hétéroclite ressemblait à un véritable capharnaüm.
C’est en brimbalant et le moteur toussotant et crachotant comme s’il allait rendre l’âme que le démarrage se faisait. La route étant parsemée de nids-de-poule, et comme l’engin dans lequel nous nous trouvions était dépourvu d’amortisseurs c’était les dos en compote qu’une heure trente plus tard, durée du voyage, que nous descendions enfin de cet épouvantable engin roulant.
Pour ceux qui rêvaient d’horizons lointains, pas besoin de visa ; d’ailleurs, il n’existait pas encore pour se rendre en France, il suffisait de s’inscrire au bureau de main-d’œuvre, là-bas ils avaient besoin de bras vigoureux pour des travaux de forçats. Tous les métiers pénibles et rebutants étaient réservés à nos compatriotes.
Pour les arrivants dans l’Hexagone, c’était boulot, métro, dodo. Dans des chambres minuscules où on s’entassait à quatre ou huit personnes, les harassantes besognes qui leur étaient désignées, les toilettes, douches et cuisines collectives et le froid auquel ils n’étaient pas habitués a forcé les moins téméraires à prendre le bateau en sens inverse pour revenir au bled. C’était le cas de Mamou, Rabah, Messaoud et beaucoup d’autres. Après vous avoir fait un topo sur la gent masculine et le bon vieux temps dont ils jouissaient, je vais passer à celui de la gent féminine. A l’époque, respectueuses des us et coutumes, presque toutes les femmes et même des grands-mères de plus de quatre vingts ans, lorsqu’elles sortaient, camouflaient leurs formes en portant le haïk (voile traditionnel algérien de couleur blanche) qui les couvrait de la tête aux pieds et cachaient leur visage en laissant apparaître les yeux, c’était l’aâjar avant toute sortie dehors. Pour nous les hommes, seuls les yeux et une petite mèche de cheveux parfois laissée libre nous permettaient de nous faire une vague idée sur la beauté de la dame. Il arrivait que cela engendrait des mésaventures cocasses. Mon oncle Mouloud, un dragueur invétéré, a eu la honte de sa vie à cause du fameux aâdjar. Un jour qu’il croyait avoir eu une touche avec une belle demoiselle, il s’est mis à la suivre et l’embêter avec son baratin habituel. Arrivé au coin d’une rue, la jeune fille s’arrêta, fit face à son harceleur et d’un geste rageur enleva le voile qui lui cachait le visage. C’était sa tante Salima. Si la terre pouvait s’ouvrir à cet instant-là, il aurait volontiers accepté qu’elle l’engloutisse. Il fut durant plusieurs jours la risée de toute la famille.
La ségrégation était telle que lorsqu’ un étranger est invité à l’intérieur d’une habitation, il fallait qu’il soit obligatoirement accompagné par un guide de sexe masculin qui a pour mission de crier à haute voie trâk !, ce qui voulait dire ouvrez le passage, et ce, dès la porte d’entrée principale franchie. Cet ordre tonitruant lancé, toutes les femmes et jeunes filles se trouvant dans les parages doivent se cacher pour ne pas être vues par l’inconnu. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour ces femmes vertueuses et courageuses, car il fallait avoir du cran pour accoucher à la maison en étant simplement guidées par une belle-mère ou une voisine, sans faire trop de chichi.
Il me faudra des heures et des heures pour énumérer tous les exploits de ces héroïnes qui ont beaucoup souffert des machistes que nous étions. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps les jeunes, merci de m’avoir prêté l’oreille et avant de nous quitter, je peux vous certifier qu’avant l’indépendance c’était pire. Mon grand-père ma raconté qu’il se fabriquait lui-même ses chaussures (arkacènes en kabyle) en prenant un bout de pneu sur lequel il cousait des peaux de bêtes et que pour le pain il était obligé de mélanger de la farine de glands à celle de l’orge pour que les membres de sa famille arrivent à calmer la faim qui tenaillait leurs entrailles. Sachez aussi que l’espérance de vie en ces temps-là n’était que de 47 ans, alors qu’aujourd’hui elle est de 76 ans en Algérie.
Avant de s’en aller, un des trois jeunes dit à Bachir : «Monsieur, notre professeur d’histoire nous répète sans cesse qu’un vieux qui meurt, c’est comme une bibliothèque qui brûle ! Et bien, c’est aujourd’hui que je viens de saisir la signification de cette sentence. Je vous souhaite donc très, très longue vie.»