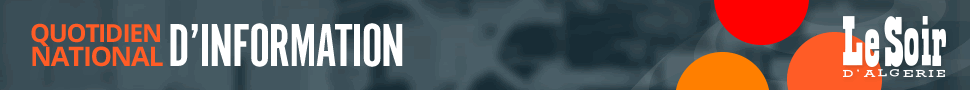Par Samir Bellal (*)
Dans une interview accordée il y a quelques jours au site d’information Maghreb Emergent, le professeur Lahouari Addi est revenu sur les raisons qui empêchent l’Etat algérien d’entreprendre des réformes économiques structurelles en vue de libérer le pays de sa dépendance vis-à-vis du secteur des hydrocarbures. Même si, dans ses intrusions dans le débat politique national, ses prises de position suscitent de nombreuses incompréhensions et, parfois, de légitimes interrogations, le regard qu’il porte, en sa qualité d’universitaire, sur la situation économique du pays mérite que l’on en rappelle ici le caractère particulièrement fécond.
Dans la dense littérature consacrée à l’analyse de l’expérience algérienne de développement, les travaux de L. Addi occupent en effet une place particulière. L’analyse que fait L. Addi des pratiques économiques de l’Etat algérien mérite, de par son apport méthodologique, les questionnements qu’elle soulève et ses conclusions, que l’on en expose ici, brièvement, les grandes lignes.
Rompant avec l’économisme dominant, L. Addi est sans doute l’auteur algérien qui, avec D. Liabès, a souligné avec le plus de force et de clarté l’importance de la problématique des rapports entre le politique et l’économique dans l’analyse de l’expérience algérienne de développement .
Pour L. Addi, l’Etat algérien a entrepris de construire une économie à l’abri du marché. Une telle entreprise pose, à travers les pratiques économiques auxquelles elle a donné lieu, le problème des relations entre l’économique et le politique, problème interpellant la capacité de celui-ci à faire mouvoir l’appareil productif.
Ignorant les lois du marché, ces pratiques donnent naissance à des rentes spéculatives, rémunérant le travail improductif au détriment du travail productif. Par ce biais, l’opposition explicite entre le capital étatique et le capital privé, opposition que l’on retrouve constamment dans le discours politique officiel qui accompagne la politique de développement jusqu’à la fin des années 80, devient dans les faits une alliance implicite à tel point que celui-ci se nourrit de celui-là.
Le refus des lois du marché ne procède cependant pas d’une volonté de les dépasser, ce qui aurait conféré à ce refus une certaine cohérence idéologique, mais plutôt d’une vision populiste. Refusant de voir la société à travers les intérêts économiques qui la divisent, l’Etat algérien ne se donnera aucun moyen pour éteindre les rentes qui se forment à la faveur de ses propres pratiques, d’où l’incohérence de ces dernières par rapport à l’objectif proclamé de construction d’une économie moderne.
Une telle incohérence, souligne L. Addi, rend difficile l’interprétation des pratiques de développement selon les grilles de l’économie politique. En fait, la pratique algérienne de développement montre le caractère contingent de l’économie politique. Extraite de son contexte historique, coupée des relations politiques qu’elle instaure entre les agents économiques, celle-ci perd toute sa pertinence. L’économie politique, rappelle à ce propos L. Addi, est une arithmétique qui met en œuvre des intérêts économiques qui s’opposent et qui se superposent. Elle suppose l’autonomie des agents économiques dont le comportement obéit à la défense de leurs intérêts propres dans un environnement de concurrence exacerbée. La mécanique économique qu’elle se propose d’étudier met en mouvement deux protagonistes : d’un côté, le patronat, obsédé par le taux d’exploitation de la force de travail, et de l’autre, les ouvriers, soucieux de négocier l’augmentation du salaire réel. De cette mécanique contradictoire, l’économie politique a déduit les concepts de surproduit, de profit, de salaire, de travail pour combattre les notions de rente, de ponction et de prédation.
Une telle définition illustre la pertinence de l’économie politique dans un état libéral, ce dernier n’intervenant en effet que dans les limites que trace l’économie politique, et sa non-pertinence dans l’Etat algérien. «Que signifie, en effet, s’interroge à ce propos l’auteur, la notion de rendement ou d’efficacité du capital dans une situation où le capital spéculatif et commercial rapporte plus que les autres capitaux ? Que signifie la notion de profit dans une situation où la rente est la source principale de l’accumulation ? (…) Que signifie la valeur de l’unité monétaire quand l’administration dispose du pouvoir absolu de battre monnaie ? Que signifie la notion d’élasticité de la demande quand les structures de l’offre sont rigides ?» La compréhension des mécanismes du sous-développement en Algérie exige de ce fait qu’elle soit cernée par une problématique appropriée dans laquelle la question de la rationalité régulatrice de l’ensemble de la société ne saurait être éludée.
Par rapport à l’Etat libéral, l’Etat algérien se trouve, de ce point de vue, aux antipodes. Tandis que le premier est assis sur une rationalité économique, le second est assis sur une rationalité politique, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, ne nie ni l’économique ni le politique. La question de l’importance de la rationalité régulatrice soulève en fait l’approche de la relation et de l’articulation entre le politique et l’économique en vue d’une cohérence sociale. Aussi, dire qu’en Algérie, la régulation par le politique prend le pas sur la régulation par l’économique ne signifie pas que l’économique n’a pas son importance puisque, de toute évidence, la satisfaction des besoins économiques est inhérente à toutes les sociétés humaines. Cela signifie que l’accumulation des richesses par des particuliers ne puise pas principalement dans l’exploitation du travail, mais emprunte le passage obligé du politique qui la favorise ou la défavorise.
Par ce biais, il se constitue dans les faits une bourgeoisie monétaire dont la source d’accumulation n’est pas la création de valeurs d’usage, mais le transfert de valeur selon des mécanismes de captage de la rente. Depuis longtemps en effet et à quelques exceptions près, le capital privé algérien se reproduira à une très grande échelle selon ce mécanisme et non sur la base de l’exploitation du travail productif créateur de richesses.
La régulation par le politique instrumentalise l’économie pour en faire une source de pouvoir politique. Une telle régulation a plusieurs manifestations. Pour n’en retenir que les plus importantes, il y a lieu de citer l’entretien d’un rapport salarial de type clientéliste dans le secteur public (transformé en un lieu de négociation et de sauvegarde des intérêts politiques du régime, le secteur public est constamment déficitaire) ; la remise en cause du rôle régulateur des prix au travers d’une pratique systématique et généralisée de subventions ; la surévaluation de la monnaie nationale (la première des subventions, selon l’expression de A. Benachenhou), pratique qui favorise l’importation et la consommation et décourage la production ; l’instrumentalisation de la monnaie au travers du recours sans limite à la planche à billets pour faire face aux déficits, etc. Le refus politique de la régulation par l’économique correspond cependant à une situation historique caractérisée par l’incapacité du champ économique à puiser en lui-même sa dynamique.
Pour L. Addi, l’expérience algérienne est un exemple suggestif de ce que devraient être — ou ne pas être — les relations entre le politique et l’économique. Dans les faits, le primat du politique sur l’économique se traduit par un déséquilibre dans les relations entre l’Etat et la société civile. Cependant, un tel déséquilibre reflète beaucoup plus l’indigence de l’économie que la puissance de l’Etat. Si la société civile dépend de l’Etat, ce n’est, souligne L. Addi, pas tant parce que celui-ci est puissant, mais parce que la nature du surproduit — une rente d’origine externe — ne permet pas à celle-ci d’avoir un poids politique aussi important que celui qu’ont les acteurs des sociétés civiles des pays dont l’économie se reproduit sur la base de l’exploitation du travail (ou de la plus-value relative).
Se reproduisant sur la base de la rente énergétique, le pouvoir d’Etat reproduit, pour satisfaire la société civile dont il veut qu’elle continue à dépendre de lui, tout un processus de redistribution de cette rente. Chétive, la société civile «colle», quant à elle, à l’Etat pour lui arracher soit des richesses à accumuler, soit de la subsistance pour survivre.
Par ailleurs, l’assujettissement de la société économique au pouvoir politique se manifeste aussi par le fait que les relations économiques se trouvent souvent imbriquées dans les réseaux politiques, rendant la notion même de concurrence dépourvue de tout sens. Ainsi, les performances économiques d’une entreprise dépendent plus de son appartenance à un clan, de ses relations clientélistes avec l’élite politique que de son efficacité productive. Dans ces conditions, l’enjeu du changement économique et social serait d’instaurer des relations économiques concurrentielles qui affranchiraient ou libèreraient la sphère marchande de toute subordination aux hiérarchies politiques. L’imbrication des activités économiques et des réseaux politiques peut avoir plusieurs degrés, mais, contrairement à ce que suggèrent les débats classiques entre «libéraux» et «étatistes», la question n’est pas tant de savoir s’il faut plus ou moins d’Etat. La vraie question est celle de la forme des liens entre Etat et économie, entre le politique et l’économique : tant que la configuration de la relation privé-public est fondée sur des relations clientélistes, l’Etat sera fatalement le lieu idoine de l’inefficacité et du gaspillage. D’un certain point de vue, le projet de réforme libérale en Algérie renvoie, quant au sens à lui conférer, à l’expérience historique de l’Europe de l’émergence du capitalisme : instituer le marché compétitif en libérant les individus-entrepreneurs des relations de dépendance qui les lient au politique. Cette libération irait de pair avec la soumission, non à des personnes, mais à des règles, celles de la concurrence, qui tendraient à contraindre à l’efficacité économique.
Il convient de noter enfin que, pour L. Addi, l’idéologie populiste qui a marqué de son empreinte l’ensemble des choix économiques de l’Algérie indépendante, s’explique grandement par l’origine historique de l’Etat algérien. Né d’une contradiction externe — la colonisation —, ce dernier poursuit une finalité politique qui refuse l’autonomie de l’économique qui divise. L’Etat algérien, écrit-il, est très soucieux de préserver l’unité de la société politique. L’Etat algérien est marqué, plus que tout autre, par le «besoin obsessionnel d’unanimité nationale». La singularité de l’Algérie est qu’elle a justement connu un néo-patrimonialisme radical, obsédé par l’absorption de tous les pouvoirs, et à commencer par le pouvoir économique.
Pour l’auteur de l’impasse du populisme, il n’est pas exagéré de dire que l’Etat algérien n’a pas d’objectifs économiques en soi ; il a des objectifs politiques dont il sait que la réalisation passe par le développement économique. Et de laisser entendre que de ce point de vue, et de ce point de vue seulement, on peut considérer que le bilan global des cinq décennies d’indépendance est positif dans la mesure où il n’y a pas de présence militaire étrangère dans le pays et que ce dernier a pu préserver une relative autonomie de décision.
S. B.
* Universitaire