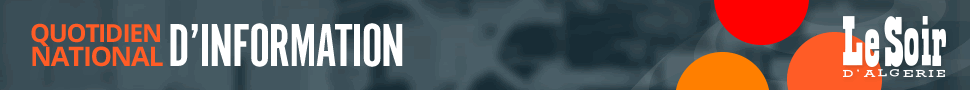Par Dr M. Betrouni
Ni les disponibilités financières ni encore la volonté politique ne constituent les préalables d’une politique touristique forte et efficiente. Réussir le tourisme c’est, d’abord, investir dans la construction de l’image Algérie. Mais encore fau...